Vendredi 17 septembre
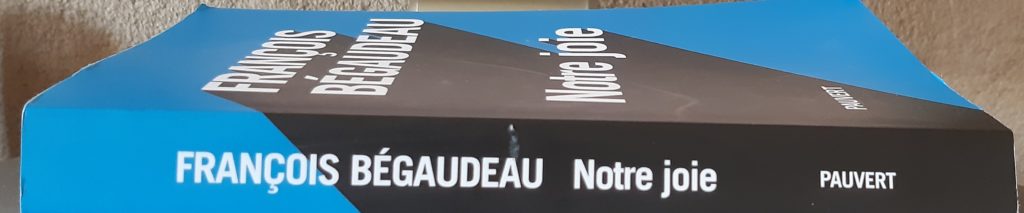
Comme à chaque fois j’ai très vite lu le dernier texte de François Bégaudeau – Notre joie, cette fois-ci un essai. La raison pour laquelle je vais si vite est le rythme. Je me fais toujours prendre, il y a quelque chose dans l’enchaînement des phrases qui pousse à avancer à vive allure. Or, je le sais maintenant puisque une habitude s’est installée : à tenir ainsi la cadence pendant plusieurs dizaines de pages je constate un effet progressif, étrange, pour tout dire un peu hallucinatoire. Par ma lecture anormalement rapide je me sais partiellement responsable de cet effet. Mais ce n’est pas pour rien. J’ai bien raison de lire ainsi. Je maintiens que les textes de cet auteur s’y prêtent. Plus encore : ils demandent, voire exigent un déchiffrage sous tension. Or le fait de loin le plus étonnant se trouve ici : dans tout ce qui est écrit, rien ne dévie jamais. Ni la grammaire, ni le propos. Je ne vois, dans ce texte encore, nulle volonté de perdre le lecteur, et d’exprimer une quelconque folie encore moins.
Au contraire la succession des idées est on ne peut plus rigoureuse. Les phrases sont plutôt courtes – sujet, verbe, compléments ; surtout pas de fioritures ; quelques expressions figées modifiées pour l’occasion et ainsi appuyer un sens nouveau. Et pourtant si l’on n’y prend garde le flux tendu vient à provoquer comme une sortie de route. Le réel décrit gagne en intensité jusqu’à produire un trouble. Dans tout cela il faut continuer à suivre, d’autant plus que la progression s’avère serrée (comme je parlais il y a quelques jours de scénario serré : aucune place pour le vide, le temps mort ni même l’hésitation). Si l’on ne veut rien perdre du raisonnement, il n’y a alors pas d’autre choix que de sérieusement s’accrocher.
Au fil de la lecture il m’arrive sans doute de manquer des éléments. Face à une telle pression parfois je failllis. D’autant que je m’obstine à lire vite. Entre l’écrit et ma compréhension il y a des pertes à déplorer. À commencer par les transitions. C’est tellement vrai que de tout le livre je n’en ai pas vraiment repéré. C’est que la radicalité de F. Bégaudeau s’est sûrement accentuée. Et si dans Jouer juste je n’avais aperçu qu’un seul point – non pas parce que n’en voyant pas j’en cherchais un à tout prix mais au contraire parce que, tombant soudain sur celui-ci aux deux tiers du roman, je réalisais a posteriori que je n’en avais noté aucun autre auparavant -, impossible cette fois de dire si cet essai contient une seule transition entre deux idées censément différentes.
Or, forme et fond ne faisant qu’un (autrement dit, la différence entre forme et fond étant une vue de l’esprit qui, soit dit en passant, ne diffère pas du corps), la lecture du texte amène à s’interroger : deux idées qui glissent ainsi de l’une à l’autre dans le sens de la lecture restent-elles distinctes ? En l’occurrence il semblerait que non. Plus tant que ça. Ici les idées se suivent. Les idées se ressemblent. Elles se contaminent. L’une pousse l’autre. Si bien que l’on se retrouve à la dernière page de Notre joie sans avoir totalement saisi par quels moyens on y est arrivé. Ce qui reste est en revanche le sentiment d’un raisonnement aussi sûr de lui qu’implacable. De ce point de vue, le texte menace en permanence de nous déborder. Embarquée dans le rythme, à moi seule donc de refuser de me laisser porter. Au lecteur de rester vigilant. D’ouvrir l’œil et continuer à découper dans le bloc des 319 pages pour séparer les idées, reconnaître leur agencement. François Bégaudeau ne nous aidera pas. Il ne nous mâchera pas le travail. Pas le genre. Sauf que.
Avec un tel rythme, disais-je, la pensée finira de toute façon par décoller pour de bon. On pourrait dire : comme détourée. Dans Deux Singes ou ma vie politique, l’auteur fustigeait sa tendance virtuose et juvénile à aimer le raisonnement pour lui-même et pratiquer l’exercice rhétorique pour la beauté du geste. Il dit les vouloir à présent tous deux solidement ancrés au réel. Pas de problème de ce côté-là, c’est le cas. Mais désormais, c’est bien à partir de la description de l’existant – une soirée de discussion à Lyon, telle conséquence très concrète du libéralisme, des événements historiques, des comportements déterminés socialement ou bien par la douleur – que quelque chose advient. Quelque chose que je reconnais pour l’avoir si souvent lu, voulu, recherché et un peu analysé.
Avant de travailler sur la répétition, objet d’étude littéraire qui s’est transformé au fil des ans en un plus large intérêt pour les procédés de dédoublement en art, j’avais travaillé sur l’incantation. À l’époque, ne comprenant pas ce que j’aimais tant chez cet auteur qui parlait à longueur de pages d’un dieu auquel je ne croyais pas, je m’étais spécifiquement penchée sur le cas Paul Claudel. Plus tard, dans mon cheminement parallèle de lectrice et d’étudiante, la répétition m’était tombée dans les mains comme une forme particulière de l’incantation, l’un de ses éléments constitutifs les plus efficaces. Je n’ai aucun doute là-dessus : François Begaudeau tisse son texte en une longue incantation. Une prière indifférente au futur qui cette fois, se passe de répétition – pas le temps pour cela. On la récitera d’une voix neutre. On s’approche : ce texte est un chant sans lyrisme ni refrain.
Par sa puissance mimétique le chant fore dans la vie. De phrase en phrase le chant va. Je ne dis pas que l’auteur parvient toujours à cet effet, et crois qu’il pourrait aller encore davantage. Mais c’est là, indéniablement, que lui et son chant se dirigent. Certes, employer un tel lexique est tentant quand on connaît le goût de F. Bégaudeau pour les textes chrétiens. Ici rien à voir en fait. J’applique pour ce livre la même méthode que pour toute autre oeuvre, et qui consiste à partir des sensations et des effets physiques – auxquels je suis plutôt prompte, on l’aura compris – que ce dernier suscite. Il aura fallu passer par le détour de l’essai et des arguments qu’il charrie à toute allure, dans une cadence qui fait la marque de l’auteur pour y voir plus clair.
« Individu est le nom mal foutu d’une zone d’échange entre intérieur et extérieur, à travers la membrane absolument poreuse qui m’entoure. Une zone où ça pense, ça mange, ça gratte, ça tombe amoureux, ça parle. Ce n’est pas moi qui parle ; c’est des mots qui me viennent, des sons qui me prennent que je ne comprends pas moi-même. La langue parle en moi. La langue dont je n’ai inventé aucun mot. Je ne fais qu’emprunter. J’attrape des vocables puis les rends. J’absorbe et je recrache. J’ingurgite et régurgite. Dans l’usine de mon corps, tout mouvement du dehors vers mon dedans a son symétrique : j’ingère autant que je chie, je boie autant que je pisse. Je ne suis pas poreux, poreux n’est pas un attribut, poreux est moi. Je ne suis que pores. La vie je la sens par tous les pores sans y rien pouvoir. Je ne maîtrise aucun des flux qui ont lieu en moi. Je suis un lieu de passage. Je suis un hall de gare. »
Note du 17 décembre 2021
Depuis la rédaction de ce billet une autre image, plus juste que le chant, m’est venue. Je la signale car maintenant que j’ai trouvé, mon imprécision me dérange. L’image est plus étonnante (moins attendue) mais cette fois c’est la bonne. C’est un geste : le mouvement du pouce que fait celui qui utilise un chapelet. Celui-là même qu’on voit faire parfois dans le métro par certains hommes absorbés dans leur tâche. En lisant c’est bien ce geste vif et répétitif – et faut-il le préciser, assez fascinant – que je voyais. Un geste qui recueille et expédie à la fois. S’appuie et élance.
Pas tant une prière donc que le geste qui l’initie (la précision me semble importante). Nulle mélodie non plus (ça je l’avais déjà identifié), mais une impulsion. On saisit, on balance puis enchaîne, car c’est comme ça que quelque chose peut advenir : de la pensée, de la vie.