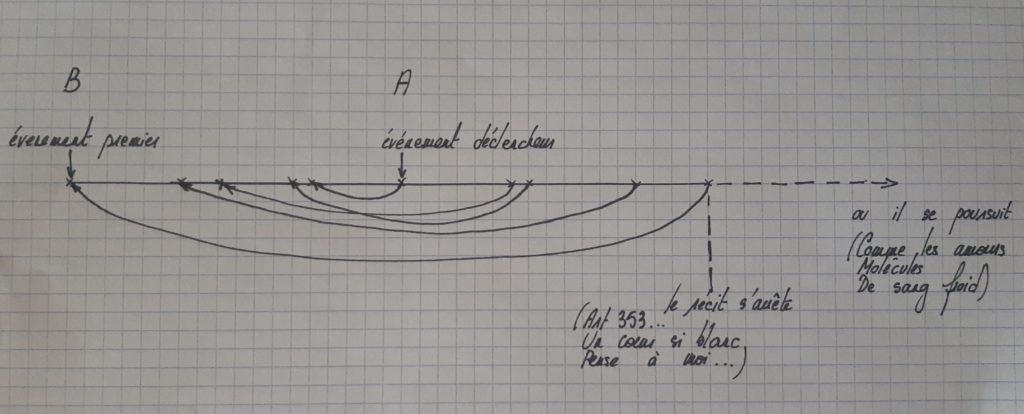Mardi 29 juin
Une nouvelle salve de Javier Marías, même si j’ai moins aimé ce dernier roman, Si rude soit le début, que ses précédents. Perdue, évanouie, cette écriture gluante qui m’impressionnait tant, je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais il y avait tout de même bien assez de fulgurances pour que je les note (et essaie de m’en souvenir). Une nouvelle salve et une dernière salve avant quelques temps, car maintenant je dois écrire mon propre texte : tout est en place pour que je m’y mette.
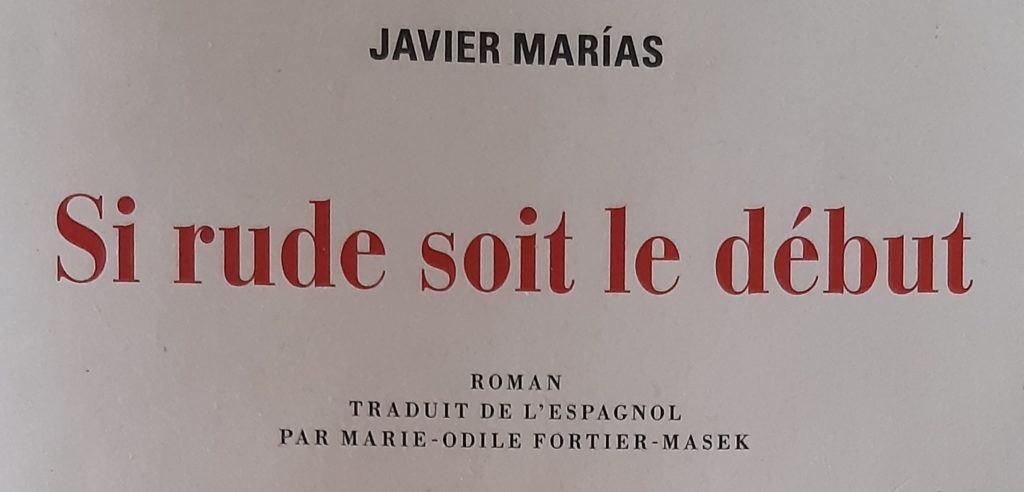
« Pour quelle raison devrait-il nous aimer, celui que nous désignons d’un doigt tremblant ? Et pour quelle rasison serait-ce précisément celui-là, comme s’il devait nous obéir ? Pour quelle raison devrait-il nous désirer, celui qui nous trouble ou nous excite et dont nous sommes éperdument amoureux ? Pourquoi un tel hasard ? Et quand il survient, combien de temps cela durera-t-il ? Pour quelle raison devrait durer quelque chose d’aussi fragile, d’aussi précaire, le plus bizarre des assemblages ? L’amour partagé, la voluptueuse réciprocité, la fièvre mutuelle, les yeux et les bouches qui se pourchassent simultanément, les cous qui s’étirent pour entrevoir l’élu parmi la foule, les sexes qui cherchent à s’unir à maintes reprises et ce goût étrange de la répétition, revenir au même corps, repartir et revenir… En général, personne ou presque ne correspond exactement à l’autre […]. »
« Elle se dirigea alors vers sa chambre, sans hâte, sa cigarette à moitié fumée dans une main, le paquet et le cendrier dans l’autre, il ne resterait aucune trace de son incursion. Elle regagnait, comme chaque soir, son lit de douleur, si ce n’est que, cette fois, elle rapportait un humble butin, une sensation. Les sensations sont instables, elles se transforment dans le souvenir, elles varient, elles dansent, elles peuvent prévaloir sur ce que l’on a dit ou entendu, sur le rejet ou l’acceptation. Parfois elles vous font renoncer, parfois elles vous donnent le courage de recommencer. »
« Peut-être imitais-je à présent les personnages de Hitchcock, stimulé par ce cycle auquel Muriel m’avait emmené sans qu’il eût à me tirer par la manche ; il y a, dans ces films, de longs passages où personne n’ouvre la bouche, sans le moindre dialogue, où l’on se contente de voir des êtres aller et venir ; quoi qu’il en soit, le spectateur regarde l’écran, hypnotisé, de plus en plus intrigué, au comble de l’angoisse sans qu’il y ait pour autant de raison objective. C’est la simple observation qui crée l’angoisse et forge l’intrigue. Il suffit de poser les yeux sur quelqu’un pour que nous commencions à nous questionner et à craindre pour son sort. »
« Et rien ne procure plus grande satisfaction que quand elles ne veulent pas, mais ne peuvent dire non. Après ça, une fois qu’elles se sont vues obligées de dire oui, la plupart acceptent, je te le garantis. Une fois qu’elles ont essayé, elles en redemandent, mais elles garderont toujours le souvenir, le sentiment, la rancoeur de n’avoir pas eu le choix la première fois. Et tu ne peux pas le savoir, bien sûr, mais rien de tel qu’un désir tout neuf emprunt d’une vieille rancoeur. »
« l’âge de Mariella Novotny quand ils l’avaient assassinée ou qu’elle était morte ou s’était suicidée »
« La notion de temps des candidats au suicide doit être étrange, car il appartient à eux seuls d’en finir, et ce sont eux qui décident du moment, c’est-à-dire de l’instant qui peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard, et il ne doit pas être aisé de le choisir, ni de savoir pourquoi maintenant et non pas quelques secondes pus tôt ou plus tard, ou pourquoi aujourd’hui et non pas hier ou demain, avant-hier ou d’ici deux jours, pourquoi aujourd’hui alors que j’en suis à la moitié d’un livre et que la nouvelle saison de la série télévisée que je suis depuis des années va bientôt passer, pourquoi je décide que je ne vais pas la regarder et que j’en ignorerai à tout jamais le dénouement ; ou pourquoi je cesse de regarder d’un oeil distrait un film que diffuse une chaîne sur laquelle je suis tombée, par hasard, dans cette chambre d’hôtel – ce lieu de passage que j’ai choisi pour me donner la mort sans témoin, seule – n’importe quoi peut éveiller notre curiosité à laquelle nous sommes sur le point de dire adieu ainsi qu’à tout le reste : nos souvenirs et nos connaissances engrangés avec patience, nos angoisses et nos efforts qui, à présent, nous semblent vains ou, en réalité, sans importance ; ces images qui ont défilé sans fin devant nos yeux, ces mots saisis par nos oreilles, passives ou aux aguets ; ces rires insouciants, ces exultations, ces moments de plénitude et d’angoisse, de désolation et d’optimisme, sans oublier ce tic-tac qui n’a cessé de nous accompagner depuis notre naissance, qu’il nous appartient de faire taire et auquel nous devons dire : « Jusqu’ici et pas plus loin […] »
« J’entrai le dernier : j’avais peur de voir la scène, surtout si elle s’était pendue ou s’il y avait du sang, tout en ne souhaitant rien en perdre, maintenant que j’étais là, jamais, jusqu’ici, je n’avais contemplé aucun mort. »
» il ne sert à rien de se prémunir, de se protéger ou de protéger qui que ce soit, il est donc absurde de souffrir à l’avance ; car, quoi que l’on fasse et en dépit de toutes nos précautions, le pire peut survenir. Et pour peu qu’il se produise, il est déjà trop tard. Et pour peu qu’il se produise, c’est fait. Comme tu le vois, elle est à présent assez détendue avec ses enfants. Au point de les laisser soudain orphelins. »
« en ma présence rien ne laissait transparaître qu’entre lui et Beatriz il y avait jamais eu ce que je savais qu’il y avait, ou peut-être qu’il n’y avait plus (on ne sait jamais au juste ni quand ça commence ni quand ça finit chez les autres) »
« l’instinct retient notre main, elle s’engourdit, elle se crispe. Cela n’a rien à voir avec la volonté. La tête peut vouloir en finir, mais la main refuse de se faire du mal » (cf le film Plongeons : la tête/les genoux)
« Chaque fois que l’on a hâte de voir quelqu’un ou de lui faire part d’une trouvaille, on a également tendance à repousser le plus possible le grand moment. Cela n’arrive, bien entendu, que si l’on est sûr de voir, tôt ou tard, la personne ou de lui relater notre histoire. »