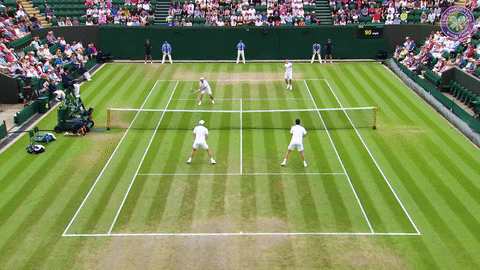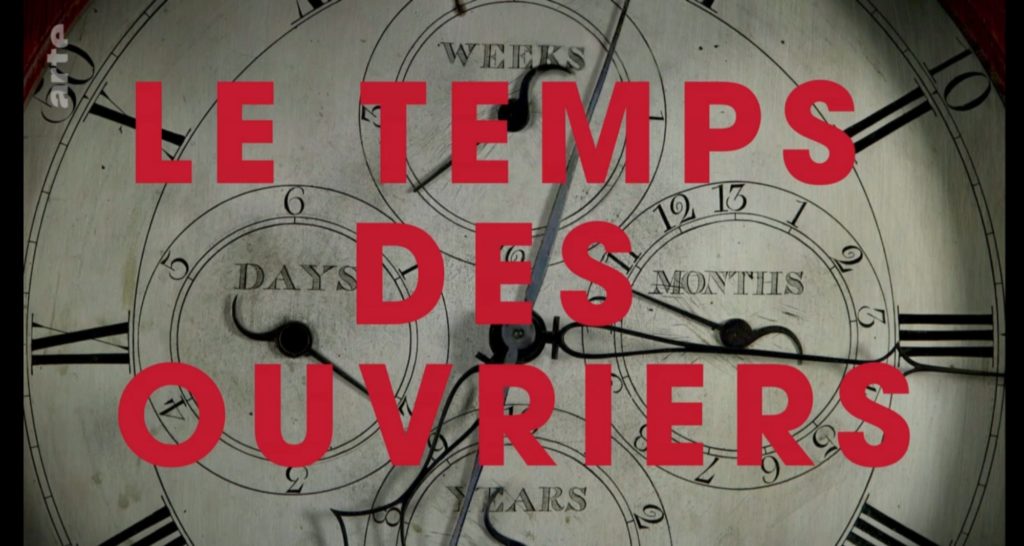Lundi 30 mai
Quand on est à court de lectures, on va au cinéma. Après Top gun version 2022, me voilà devant Il buco de Michelangelo Frammartino, qui est son strict opposé par la multiplicité de ses plans fixes, son rythme, la rareté de ses péripéties, et sa volonté même d’empêcher le spectateur d’appréhender le film comme un objet narratif. Tout au plus une mise en parallèle est-elle offerte comme un possible, mais un possible seulement, entre l’existence d’une grotte explorée en 1961 (l’abîme de Bifurto) et celle d’un vieux berger vivant alors non loin d’elle.
Les paysages filmés, extérieurs ou intimes, sont tous non seulement magnifiques, mais d’une très grande richesse. Dehors on voit dans un coin du cadre paître quelques vaches tandis qu’à l’autre bout du plan l’ombre des nuages passe sur la paroi d’une roche. Cette ombre s’imprime comme le mouvement sur la pellicule, ou l’image sur un grand écran. En multipliant ainsi les espaces de projection, sur la montagne, dans les profondeurs de la grotte, sur le visage du berger dont le front marbré se fond dans l’écorce de l’arbre auprès duquel il aime à s’asseoir, c’est le mythe de la caverne que le réalisateur semble reproduire de tous côtés. Comme s’il fallait montrer à quel point ce motif est omniprésent, répétable à l’infini, dès lors qu’on porte un tant soit peu attention à ce qui nous entoure. Tout fait cinéma. Et en apparaissant l’image, comme dans le mythe platonicien, ouvre celui qui l’observe sans a priori à une forme de vérité jusque là hors d’atteinte.

Cette manière de projeter de l’image sur toutes les surfaces est unique. Plus exactement cette manière de créer partout des supports pour mieux y projeter des images est, à mon sens, la grande performance du film. Le réalisateur parvient ainsi à construire chacune d’elles comme une succession de surimpressions, puisque souvent il joue sur les différentes profondeurs de champ. Cette approche traduit sans doute l’amour de l’artiste pour son objet, son sujet et son outil de travail. Les trois dépendant finalement d’une seule et même chose : la qualité particulière du regard.
Pour autant, si le film est intéressant, certaines de ses options ont de quoi surprendre. Certes, dans le genre film d’auteur, celui-ci a tout ou presque pour séduire : l’absence de dialogues, les paysages d’une puissance quasi mystique, le souci du détail et de la composition poussé à l’extrême. Sur ce dernier point, on peut noter quelques exemples. Ainsi, lors de la séquence de l’agonie du berger, les passages successifs des images de son auscultation à la visite de la grotte par l’équipe des spéléologues suggèrent de nombreux parallèles : la lumière projetée sur une paroi par la lampe d’un spéléologue se prolonge dans le geste du médecin scrutant l’œil du berger ; puis son ami fait couler des gouttes d’eau dans sa bouche afin de l’hydrater, rappelant irrémédiablement le suintement continu de la roche… Tout cela montre de la part de Frammartino une finesse de dentellier. Mais la recherche d’effets tend aussi à une artificialité qui dissonne avec son sujet, sa célébration de la nature. Un jeu de ballon entre deux spéléologues vu de l’extérieur s’accélère sitôt qu’il est filmé à l’intérieur de la grotte (on suppose que la scène est alors reproduite après coup et non plus filmée en temps réel) ; souvent des personnages semblent ostensiblement posés (et poser) dans le plan ; un cheval pourrait avoir été dressé pour aller fouiller à l’intérieur d’une tente pendant que ses occupants sont plongés dans le sommeil ; dans la très belle scène finale, où l’on voit un spéléologue terminer le dessin de la grotte, une brume anormalement épaisse envahit l’écran… les images les plus belles le sont souvent trop pour être honnêtes.
De façon plus générale, l’intervention appuyée des hommes – de l’équipe des explorateurs, du médecin – mais aussi immanquablement et par ricochet, du réalisateur – finit par gêner la tranquillité du lieu autant que la sérénité de l’image. Après tout, que viennent faire tous ces hommes dans la grotte sinon du bruit, sinon la percer à coup de pioches et la souiller de feuilles de magazines à moitié brûlées ? Que vient faire le médecin à part triturer dans tous les sens un vieux berger qu’on sait déjà mourant ? Ces questions, difficile de ne pas se les poser tant le calme et le silence du début cèdent en cours de route à une forme d’agitation.
Et à son tour, le film tout entier prend le risque – assumé – du maniérisme. Tout y est méticuleusement travaillé au point de faire de la seule succession des tableaux sa véritable finalité. Le corrolaire, ou la conséquence la plus radicale de ce choix esthétique est le refus quasi total de narration que j’évoquais plus haut. La boucle est bouclée, et ce qui faisait la force de l’œuvre s’avérera tout autant sa faiblesse. Car on pourrait résumer ainsi : Frammartino fictionne mais ne veut rien narrer. Il compose sans faire de récit. Mieux : il compose avec le plus grand soin son absence de récit.