Vendredi 2 décembre
L’offre. La demande.
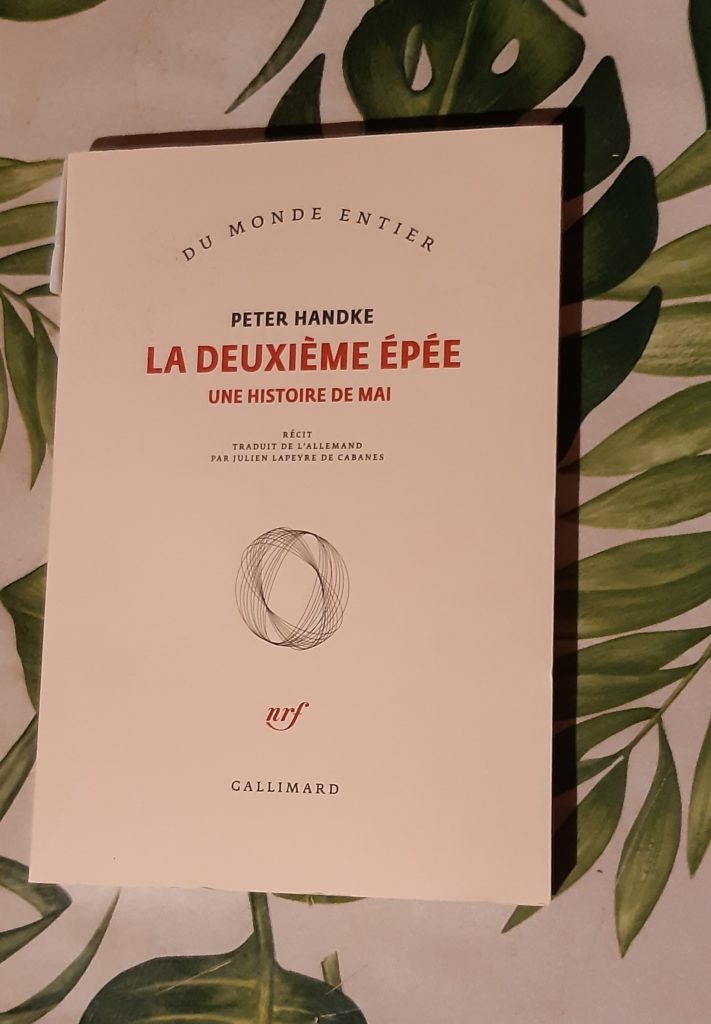
Sarga
Vendredi 2 décembre
L’offre. La demande.
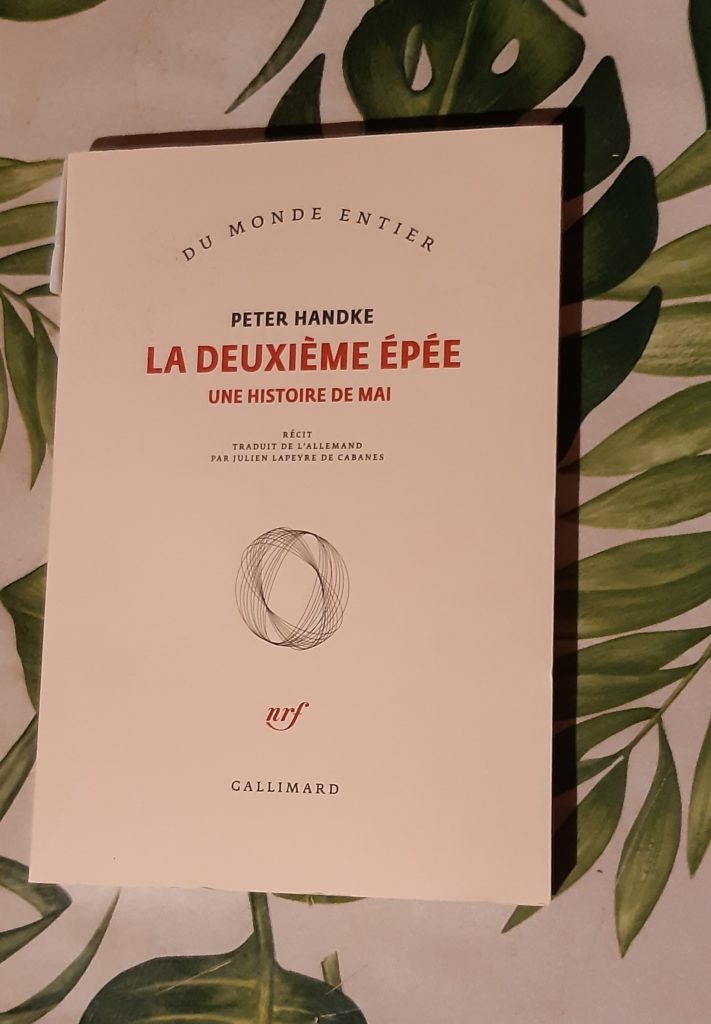
Jeudi 1er décembre
La demande. L’offre.
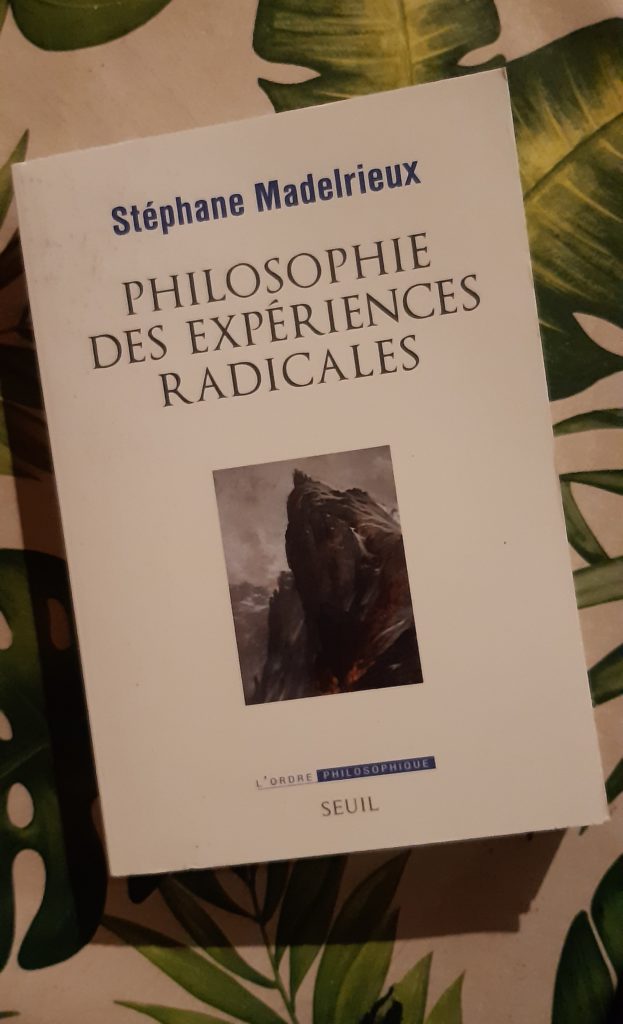
Mercredi 30 novembre
Longue vie à ma prof de sport qui a mis le Wu Tang Clan pour accompagner l’entraînement.
La musique à elle seule décide de sa saveur.
Souvent elle est joyeuse, festive. Acidulée à nous tenir au bord du rictus.
Parfois elle est si épicée, elle échauffe tant nos corps que les transes qu’elle provoque forgent une accoutumance.
Ce soir elle était astringente et nous menions une guerre.
Une guerre noble – classe – et peut-être sans objet.
Une fausse guerre mais tout de même.
Une guerre de quarante-cinq minutes.
Dimanche 13 novembre
Je découvre via ce documentaire Albrecht Dürer (1471-1528) et ses incroyables autoportraits.
Quelques-uns d’entre eux, les plus simples, les plus fragiles, dans l’ordre chronologique :




Mardi 1er novembre
Ce morceau – le seul de U2 que j’aie jamais écouté en entier, de moi-même du moins – dont le clip m’avait marquée à l’époque, et que j’avais oublié jusqu’à hier soir. Le tout m’est revenu d’un coup, je ne sais pourquoi ni comment. Hop, le voilà.
J’adore :
– comme The Edge se retient de rire tandis que les pieds se baladent sur ses lèvres
– la cuillère de yaourt (sans sucre ? salé ?)
– le petit blouson, aussi
Lundi 24 octobre
Drôle. il y a quelques jours, je me suis fait mal au bas du cou exactement au même endroit que le narrateur de Trois cafés. Au début j’ai cru que c’était un banal torticolis ; puis la nature et le lieu de la douleur, ainsi que son apparition soudaine (quoique matinale, elle a bien eu lieu après mon réveil et non pendant mon sommeil) m’ont plutôt dirigée vers l’hypothèse d’un faux mouvement. Un de ceux qu’on fait quand on est pressé et encore refroidi, le matin, avant d’aller au travail.
L’expérience m’a appris que lorsqu’une douleur apparaît, que ce soit au niveau d’un organe interne (système digestif sous la sangle abdominale) ou bien d’un muscle ou d’un os (tout le reste du corps), il est plus bénéfique de mouvoir la zone inflammée, quitte à appuyer franchement là où ça fait mal, que de la laisser se reposer. Le tout étant d’agir sans précipitation afin de rester concentré sur les réactions du corps aux mouvements effectués.
Ainsi, lassée de cette douleur persistante, mais aussi parce que j’en trouvais le temps pour la première fois depuis son apparition quatre jours auparavant, je me suis décidée à faire un certain nombre de ces mouvements pendant près d’une heure.
De tels moments, de silence et d’attention extrême à ce qui travaille en soi, sont rares. Trop rares, puisque ce que j’ai observé alors s’est avéré passionnant. Toute la question est de savoir si l’on peut rendre de telles observations à l’écrit. S’il est possible de restituer ce qui se joue au fond de la matière et la rend si fascinante.
En penchant la tête de tout mon poids du côté douloureux (gauche), je sentais aussitôt une contraction sur le trapèze. Alors, un fourmillement courait tout le long de mon bras déroulé pour s’échouer, plus mordant, dans le creux de la main. Juste au milieu, là où se rejoignent les métacarpes. Je gardais la main bien relâchée (autant que ma tête, disons que je faisais en sorte que le mouvement de détente se fasse en même temps aux deux extrémités du corps) et, tout en gardant les yeux fermés restais entièrement concentrée sur cette sensation. Elle n’était pas totalement désagréable, mais c’était étrange et nouveau de sentir une douleur située tout en haut du corps trouver ainsi une résonance, son exacte équivalence, au bout du bras. Comme si de minuscules insectes grouillants, emportés dans un tourbillon d’eau vers le siphon d’un évier, mordaient et plantaient des griffes tous en même temps pour se retenir de tomber.
Je me concentrai uniquement sur la paume et cette impression de grignotement intérieur pour ne plus prêter attention à la partie du haut. C’est ainsi que la douleur au cou m’a semblé diminuer et que j’ai pu, grâce à ce répit, entamer une série de mouvements que je n’arrivais plus à faire depuis mercredi. J’effectuais tout dans une extrême lenteur, à la fois pour bien garder conscience des sensations, de leur lien avec les mouvements et les positions de chaque partie du corps, mais aussi pour prévenir toute contraction soudaine et éviter, ainsi, de me blesser davantage.
Parmi ces mouvements, quand je formais avec la tête des cercles de droite à gauche, l’épaule se soulevait à l’arrivée de celle-ci sur le côté douloureux. Malgré tous mes efforts, je n’arrivais pas à maintenir cette zone détendue. L’épaule appréhendait la tête. Rien à faire, à l’approche du crâne alourdi ça se contractait, là, côté gauche, sous la chair ; à un endroit que je ne pouvais pas atteindre, ni en massant, ni en y enfonçant les doigts pour soulever la petite masse musculaire posée entre les deux tiges, les os de la clavicule.
J’insistai pourtant, désireuse – avide – de comprendre ce qui pouvait bien se bloquer à cet endroit précis. Tout en prenant soin de soutenir mon cou et de le protéger (dans cette position, pour accompagner le mouvement du cou et soulager la tête j’avais placé ma main – celle-là même qui me démangeait lorsqu’elle était tirée vers le bas – entre le trapèze et l’angle de la mâchoire), je faisais de petits mouvements de balancier. Front en avant, puis crâne en arrière. Front en avant, crâne en arrière. De petits craquements, des frottements profonds, venus de loin et non comme cela peut arriver souvent de surface, se produisaient à rythme régulier. À chaque aller, à chaque retour. Pourtant, je sentais les tissus et les fibres se relâcher peu à peu.
J’ignore ce que j’ai modifié à l’intérieur de cet entrelacs de nerfs, de muscles, de fascias et d’ossements. Est-ce qu’à force de bouger j’ai remis un morceau qui s’était déplacé ? Est-ce que j’ai défait un noeud ? Suis-je venue à bout d’une contracture ? Quelque chose s’est-il à nouveau mis à circuler qui était écrasé ? Je ne le saurai jamais. À l’issue de ces exercices, sans voir le mal entièrement disparu, je pouvais à nouveau tourner la tête à 180 degrés.
Dimanche 2 octobre

Le cycle de conférences de Réseau salariat commence demain avec Bernard Friot.
Toutes les infos et le calendrier en suivant ce lien.
Vendredi 12 août
Rêver que l’on a gravi, à main nue, le gros rocher qui faisait face. Se réveiller en dansant.
Mardi 26 juillet
Mercredi 6 juillet
Tandis que des enfants tapaient dans un ballon, assise au bord du terrain je relevais sans en avoir l’air trois phrases de Chester Himes.
1) Pour l’image, éminemment plaisante : « De temps en temps une ligne, une phrase l’écorchaient au passage comme les ronces s’accrochent aux vêtements dans un bosquet. »
2) « Le soleil brillait sur Harlem et se glissait dans l’interstice des rideaux. » Le mouvement, allant une fois de plus du large ciel vers le détail infime, a quelque chose d’émouvant. Il faudrait dire : est d’une efficacité redoutable. À reprendre d’une manière ou d’une autre pour l’évocation du soleil naissant dans la chambre d’Élodie.
3) « Il s’imaginait que ce régime de gin, œuf, lait et chocolat augmentait sa puissance virile, mais il ne savait pas à quoi lui servait cette puissance. » La phrase je crois se passe de commentaire. Sa chute, surtout. Je n’ai pas pu aller très loin encore dans la lecture de Fin d’un primitif, mais j’ai l’impression que l’auteur (que je découvre) a beaucoup d’humour. Un humour presque en creux, pince sans rire. Et à la fin, je le pressens déjà, ravageur.