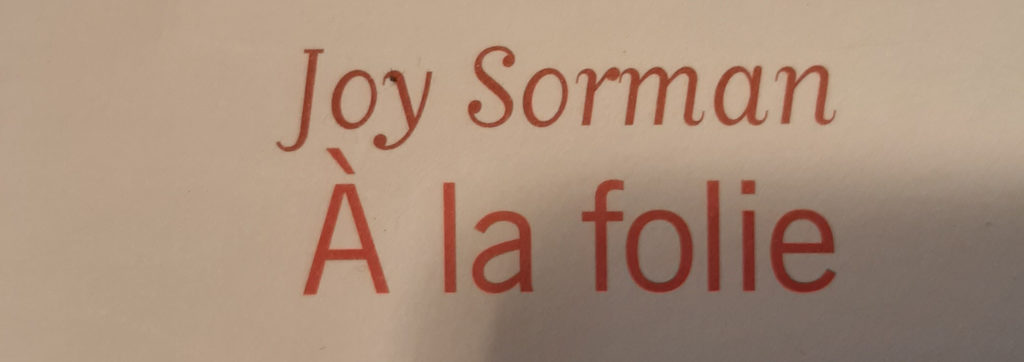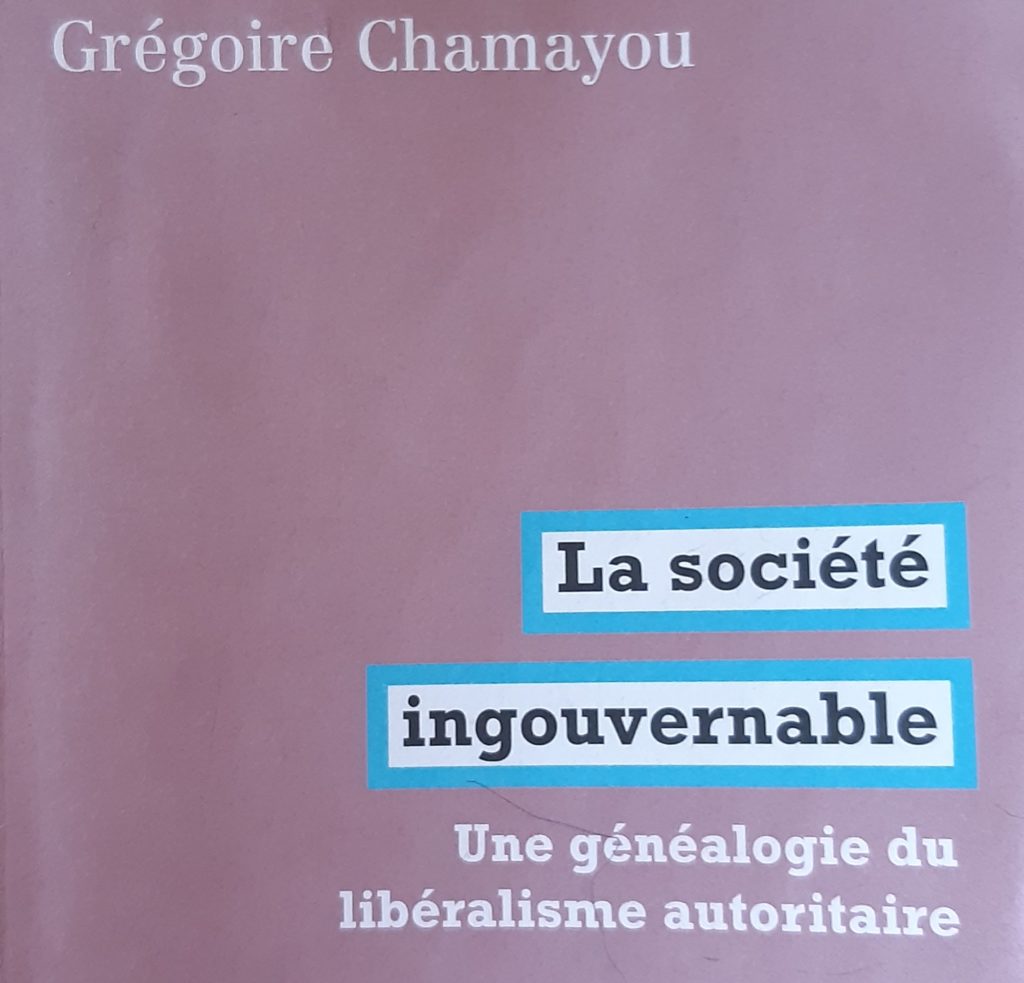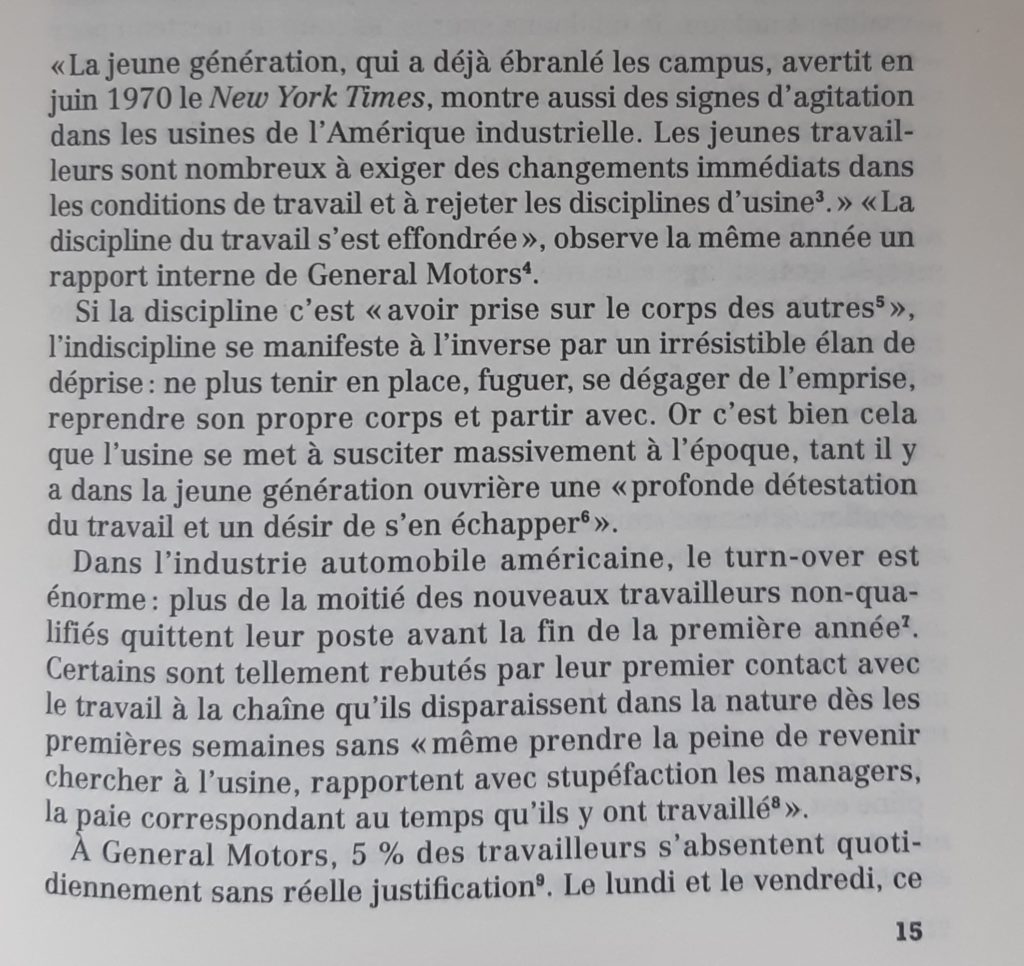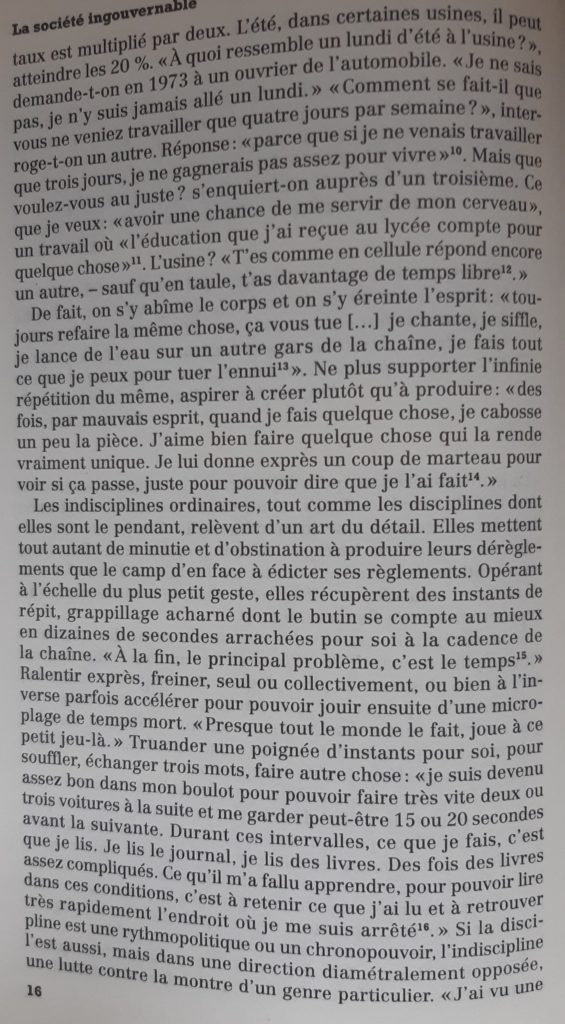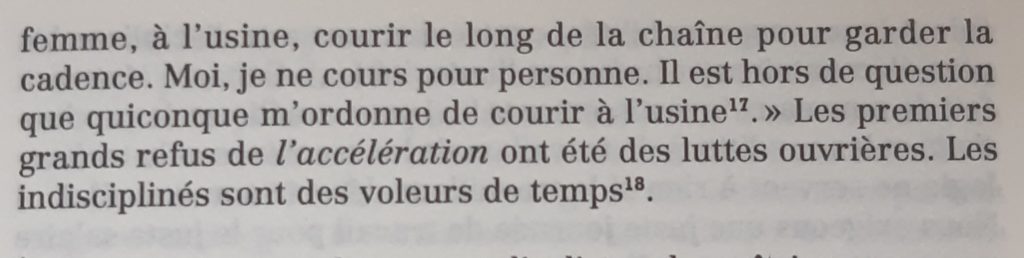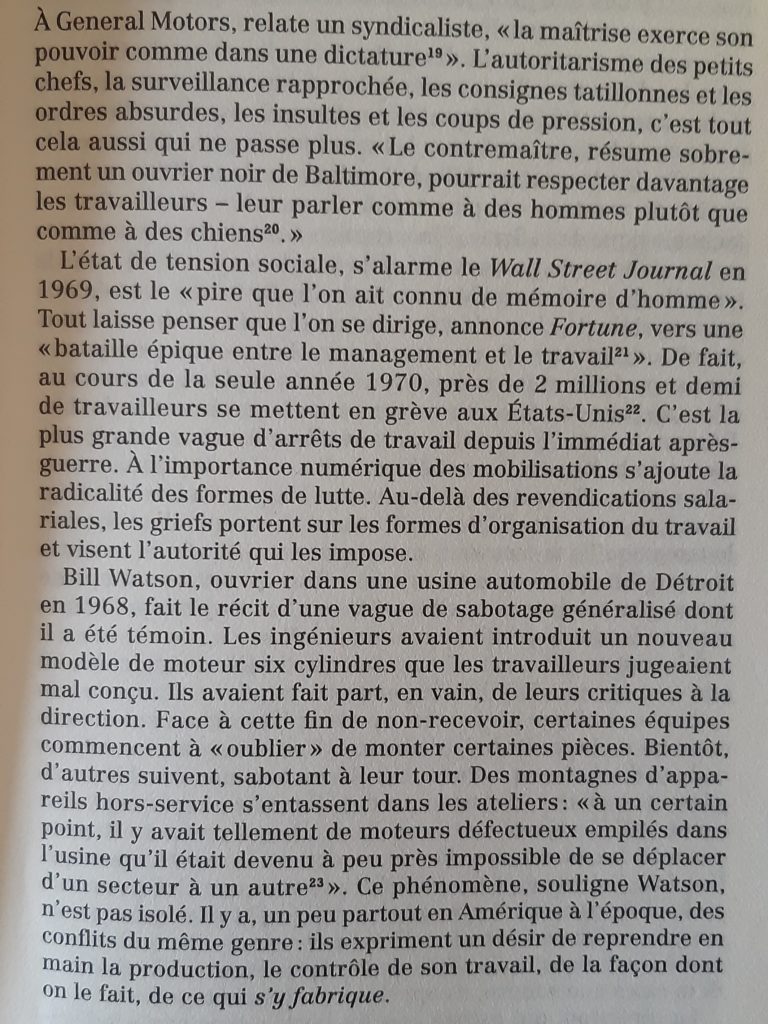Dimanche 22 août
Le lien d’Ingmar Bergman est un film déroutant, peut-être tout simplement inégal. Il raconte la passion adultère d’une mère au foyer bourgeoise avec un jeune archéologue. Je ne m’attarderai pas sur ses aspects esthétiques, qui peuvent à eux seuls freiner l’adhésion et couper l’enthousiasme. Ce film comporte tout de même des éléments suffisamment marquants pour que je les note :
1 – La scène où David et Karin deviennent amants, ou du moins scellent leur amour. On pourrait dire : l’officialisent entre eux sans le rendre officiel aux yeux des autres – sauf à dire que l’adultère même secret est une situation sociale à part entière, ce qui me semble être toute la question posée par ce film.
À ce titre, le dialogue entre les deux personnages est, je crois, assez inédit. Il s’inscrit dans le sillage déjà tracé par David informant fièrement Karin de son coup de foudre dès son premier dîner chez elle et son mari Andreas (puis, un peu plus tard dans la soirée, tandis que les trois regardent des diapositives, David demandant à Andreas à voir une photo de Karin nue). Ici donc, la séduction consiste à jouer cartes sur table. À moins qu’il n’y ait justement pas de tentative de séduction (les personnages étant conquis a priori). C’est cette indécidabilité qui est intéressante.
Dans le petit appartement miteux de David, nulle conversation galante ne vient occuper le silence entre ceux qui se sont retrouvés dans le seul but de coucher ensemble. Au contraire, il n’est question que de la marche à suivre, évoquée par les deux d’un même air ravi. Par son originalité, le dialogue retient l’attention et attise la curiosité. De ce point de vue, une séduction opère bien sur le spectateur. Jusqu’à ce que Karin desomais étendue sur un lit recommence à parler, cette fois de ses complexes et de son mariage, de ses craintes, de ses attentes. La parole se met à déborder, et les confidences deviennent pénibles, pour David à coup sûr. Pour le spectateur le comique affleure aussi. Désir des personnages, désir du spectateur de voir leur désir assouvi, puis gêne, dans des mesures similaires ou bien décalées… Ici, tout se superpose et se croise. Il y a du jeu. Et la pluralité des options dans un instant si court et une scène si intimiste me semble remarquable. Par la suite, l’acte sexuel pourtant envisagé et presque organisé par le couple naissant n’aura pas lieu. Pour autant, une relation intime a bien pris corps (postures, gestes, mots et surtout, une fois retombée toute forme d’excitation : sommeils synchrones).
2 – Toutes les scènes montrant la vie paisible, rangée et parfaitement réglée de Karin au sein du cadre bourgeois que lui assure son mari. On voit très bien ici comment la fonction de mère au foyer consiste avant tout autre chose à perpétuer le bien-être domestique, symbolisé notamment par la couleur blanche, omniprésente. La vie se déroule selon un rythme agréable d’où tout stress est absent. Le ron-ron quotidien est légèrement bousculé par une activité, une visite nouvelles, on n’aurait presque pas le temps de voir les jours passer. Pourtant, une fois sa mission du jour accomplie, Karin se retrouve oisive. Dans ce contexte, l’instauration d’une routine dans la routine, celle des rendez-vous amoureux, vient à point. Karin a tout d’une Emma Bovary. Quant à son amant, il s’avère impulsif et violent. Il ne supporte pas de voir la femme qu’il désire jongler là encore tout à fait confortablement entre ses deux vies (elle se plaindra plus tard de la difficulté de sa situation, mais rien dans ce qui nous est montré ne l’atteste).
3 – Ce très court dialogue :
(Karin a reçu une gifle de David et a une petite marque sur la lèvre. Le soir à la maison, Andreas son mari lui demande ce que c’est, elle fait mine de l’ignorer. Le couple est filmé de près.)
« Est-ce que tu crois que je manque de vitamines ?
Petit sourire d’Andreas : Non, ça m’étonnerait. »
Tout – à la fois la violence de la relation adultère (lèvre), la capacité au mensonge froid qu’il produit (ici chez Karin) et l’immense sécurité propre au mode de vie bourgeois – est concentré dans ce très bref instant. Ce qui semble anecdotique est tout l’inverse : fulgurant.
4 – À partir du moment où Andreas fait savoir qu’il est au courant de la relation adultère, la narration bascule dans quelque chose d’étrange, un peu confus. Mais cette confusion pourrait signifier avant tout l’état des personnages. Andreas subit la relation adultère de sa femme ; pendant tous ces mois il ne la quitte pas. Mais quand elle part à Londres retrouver David qui vient de la quitter, il lui signifie que ce voyage mettra définitivement fin à leur union. Pourtant elle reviendra à la maison peu après, sans qu’on en sache davantage sur le revirement d’Andreas (est-ce parce qu’elle est enceinte ? Andreas s’était-il contenté de bluffer ?). De même, David part, puis revient, annonce comme un bon politicien qu’il a changé. Quant à Karin, elle renonce à David sans qu’on sache exactement pourquoi. Elle quitte Londres sans l’avoir vu, et quand il revient la chercher, elle lui assure vouloir faire son devoir (c’est-à-dire, nous l’avons vu de nos yeux, s’occuper du confort domestique). Tout porte à croire que lors de cette ultime scène, les amants se voient pour la dernière fois. Mais après tant de revirements inexpliqués, cette dernière fois pourrait tout aussi bien s’avérer un énième épisode.
C’est une fin de récit, et pourtant celui-ci ne me semble absolument pas arrêté : rien n’empêche d’imaginer qu’en fait, les personnages sont pris dans un cycle voué à se reproduire éternellement et dans toutes les variations que l’on a déjà vues. On aurait donc fait le tour, ou plutôt un tour, mais d’autres à peu près semblables pourraient suivre. Finalement, ce qui promettait d’être l’histoire d’un triangle amoureux assez conventionnelle ne s’avère classique ni dans son commencement (1), ni dans son issue. Celle-ci alors serait une forme d’enfer, et l’histoire une malédiction ; un mythe de trois Sisyphe ou bien un jour sans fin, dû à l’incapacité de chacun des personnages à trancher. Pour être sincère, je ne sais pas si c’est là la conclusion qu’a souhaité donner Ingmar Bergman à son étrange film. Tentons de le dire autrement : je ne sais pas si c’est un film sur l’indécision ou s’il est indécis.