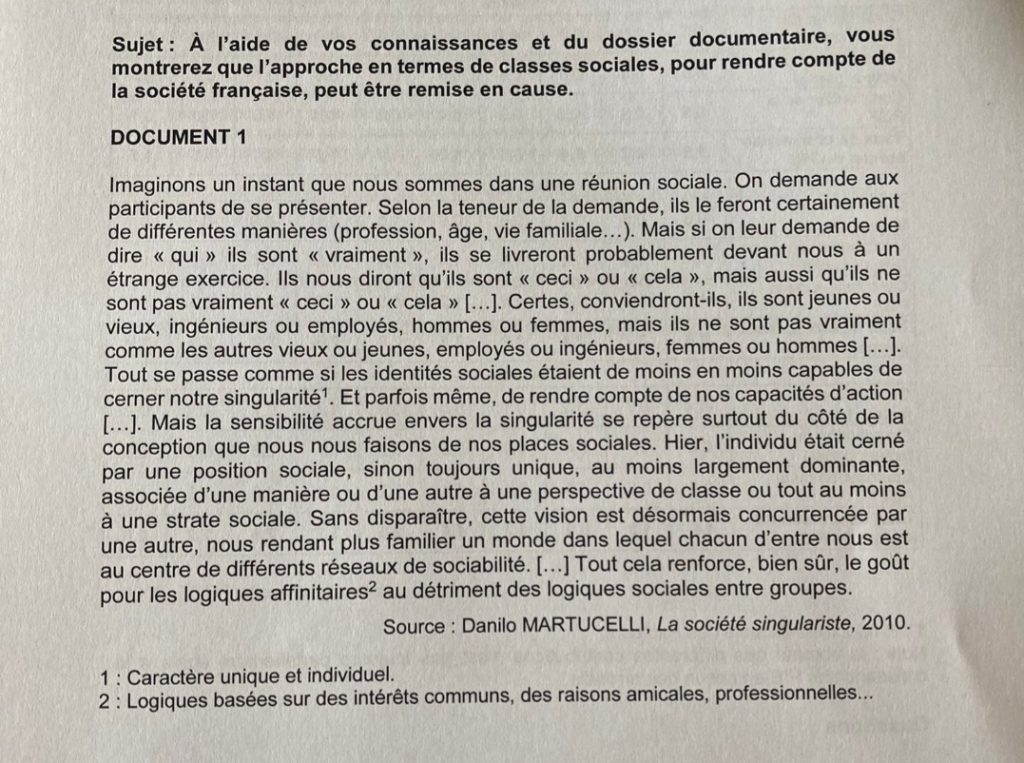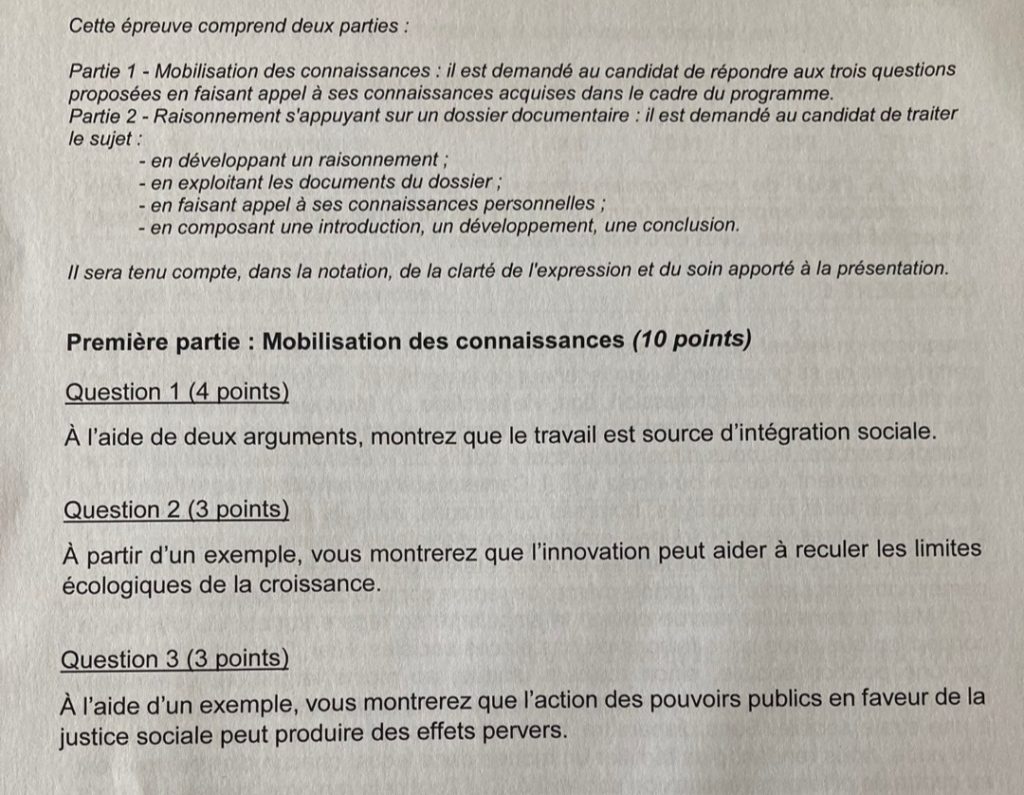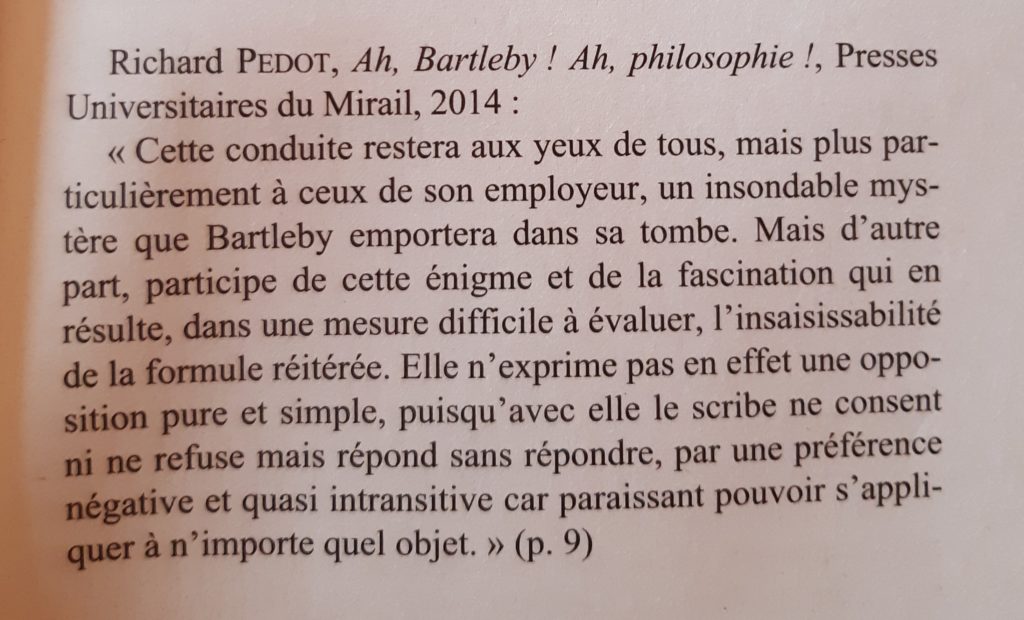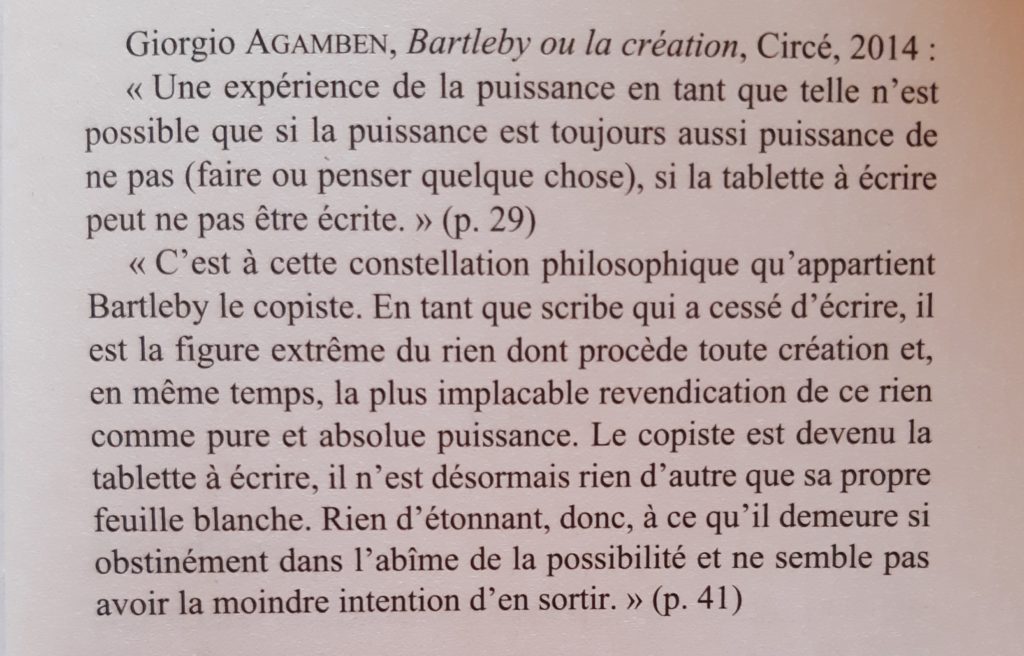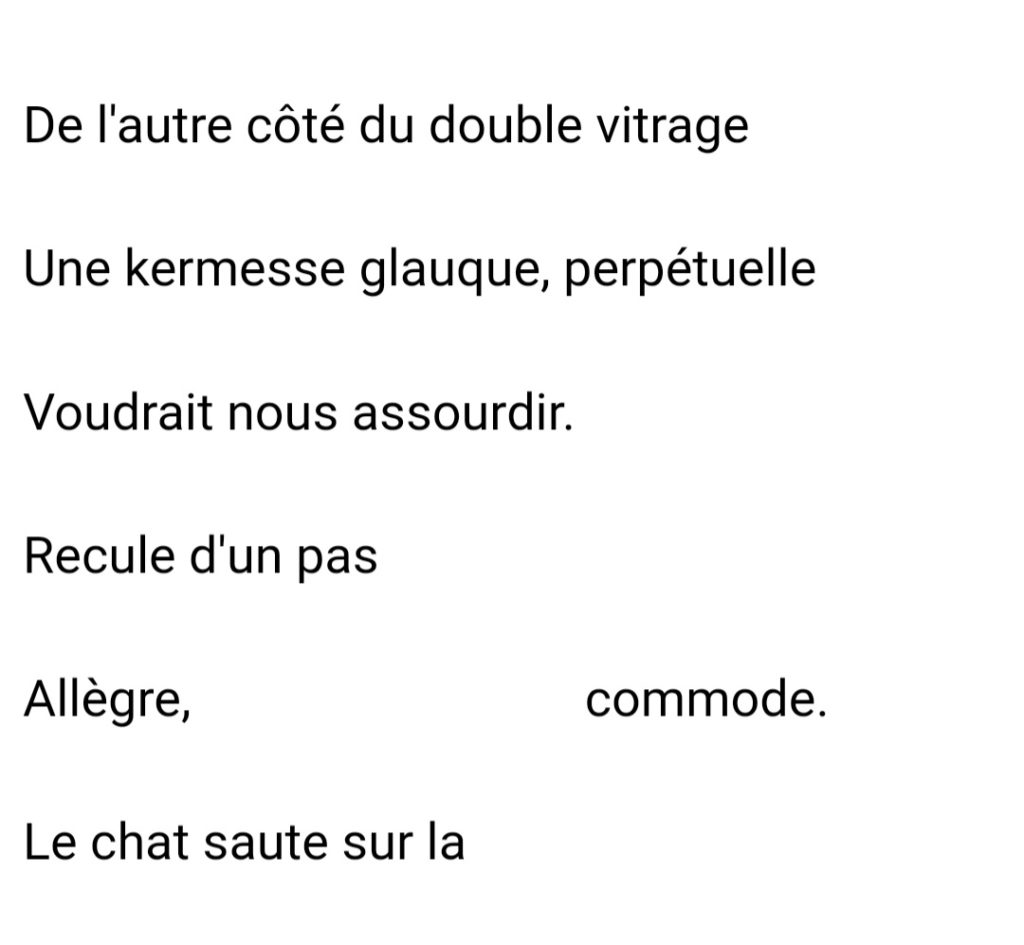Dimanche 15 mai
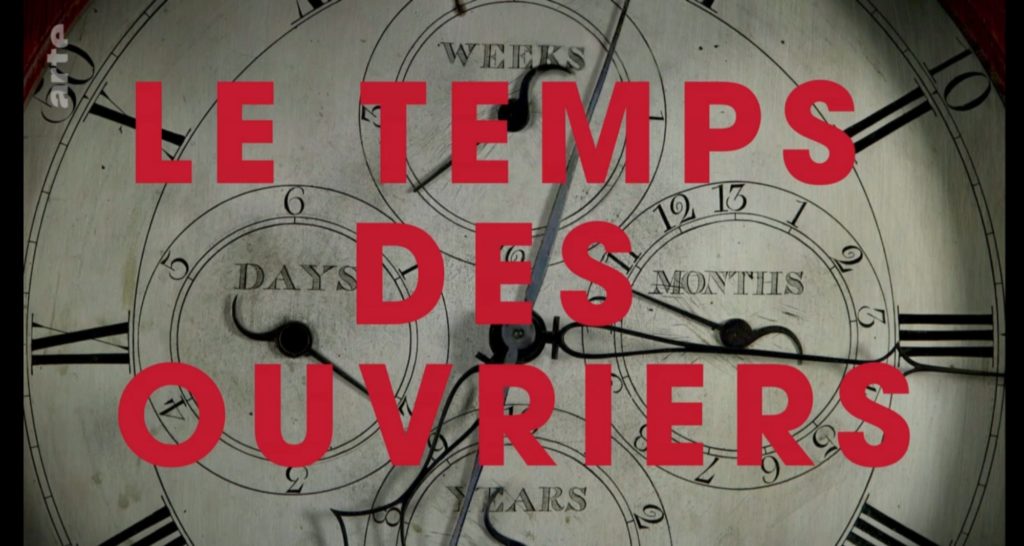
Ce très bon documentaire sur la condition ouvrière, remarquablement illustré et dont la musique rappelle les fiévreux riffs de guitare de Neil Young dans Dead man, retrace l’histoire d’une conscience de classe et des luttes qui l’ont accompagnée, de sa naissance au début du XVIIIème siècle à aujourd’hui. Les passages décrivant les journées interminables des travailleurs, montrant de très jeunes enfants à la tâche, évoquant, citations à l’appui, les considérations glaçantes des patrons, sont particulièrement marquantes. On a beau le savoir, on est toujours remué de voir des êtres humains traités par leurs semblables comme des outils, considérés comme de simples rouages, les millions de boulons d’une grande machine. Réduits à des demi-vies, rendus interchangeables et destinés à la casse dès lors qu’ils sont devenus inutiles.

Mais justement, il manque ici un élément de taille. Au terme de la série de quatre volets, la délocalisation des usines « toujours plus à l’est » est à peine mentionnée. Elle l’est uniquement pour expliquer la fin de la conscience ouvrière. Car telle est la conclusion du documentaire : atomisée, individualisée et anesthésiée par la répression ultra-libérale, le sentiment d’une appartenance à la classe laborieuse aurait disparu en cinquante ans. La thèse de Stan Neumann est la suivante : les ouvriers existent encore en Europe, mais ils ne le savent plus.
Cette croyance est à mon sens une énorme erreur, malheureusement commune, qui reconduit une lecture marxiste de la société occidentale sans admettre que celle-ci s’est non pas modifiée, mais littéralement métamorphosée. Soudain saisie d’une étonnante schizophrénie, elle nie tout en le déplorant ce déplacement des forces productives. Le documentaire le dit pourtant : les ouvriers en France représentent aujourd’hui 5% de la population. Il faut saluer à ce titre l’apparition dans le film de Joseph Pontus, employé intérimaire et auteur dont j’avais évoqué le très bon livre À la ligne, publié peu avant sa mort. Pour autant, les ouvriers ne sont pas réduits au silence, comme on l’entend et le lit souvent, par une hypothétique individualisation propre à l’occident : ils n’existent plus. Autre chose a émergé de leur histoire. Pourquoi donc s’acharner à plaquer des catégories qui ne décrivent plus les modes de vie contemporains ?
C’est au contraire le meilleur moyen de passer à côté des nouvelles formes d’aliénation que connaît la majorité écrasante de la population des pays développés, en ignorant les véritables effets pervers du capitalisme. Eux sont bien plus nombreux et problématiques qu’un éventuel mépris « de classe » (sous-entendu laborieuse) pourtant clamé à longueur d’antenne. Cette formule s’est avérée au fil des ans le moyen le plus sûr de s’exonérer de penser la très complexe et très protéiforme classe moyenne.
C’est aussi une manière bien commode d’ignorer ce qui se passe ailleurs. La vérité, la seule, et qu’on ne cesse d’occulter en rhabillant par exemple les gilets jaunes en masse exclusivement douloureuse, c’est que les prolétaires sont désormais à l’autre bout du monde. À ce prolétariat-là, lointain, invisible, silencieux, le documentaire consacre une phrase. Une phrase en tout et pour tout à l’égard de ceux qui fabriquent la grande part des objets dont nous bénéficions, nous membres des classes moyenne et supérieure. Je m’empresse de le préciser : ces objets, éléments d’un véritable quoique relatif confort matériel, nous les obtenons de ce côté-ci au prix d’un détricotement constant de la législation sociale, d’un allongement du temps de travail de toutes les catégories socio-professionnelles, d’une pression croissante sur les chômeurs, mais aussi d’ubérisarion, de précarisation, de temps-partiels féminins, de burn-out divers et de stress variés infligés par toutes nos hiérarchies : voilà autant de sources de souffrance, certes, mais qui ne sont en rien des problématiques ouvrières et, faut-il ajouter, rarement prolétaires.
Un amalgame, ainsi, perdure. Par tradition, par filiation à un camp politique ou à ce qu’on en imagine. Pourtant cet amalgame insulte le réel, et avec lui tous ceux qui le peuplent. Plus encore dans un film dont l’ambition est de documenter très précisément l’histoire des ouvriers. Le prolongement des images du XIXème, il se trouve actuellement en Afrique et en Asie. C’est là que travaille la masse des ouvriers, enfermée sans protection 15h par jour. Toute tentative de le ramener en France constitue au mieux une approximation, au pire un mensonge. Cela ne signifie pas qu’on doive ignorer les difficultés spécifiques à l’organisation du travail occidentale, mais le minimum est de les identifier et de les qualifier correctement.
Alors oui, n’en déplaise aux libéraux, le marxisme est toujours d’actualité. À l’échelle mondiale. Tout le monde le sait ; bien peu l’intègre dans ses réflexions. Si ce n’est pour déplorer la disparition de sites industriels en Europe, dont on dénonçait naguère (et à juste titre) les conditions de travail odieuses imposées aux employés… Bon. Posons un peu les choses et regardons-les de manière objective. Pour rappel, 10% de la population mondiale possède 86% des ressources globales. 50% ne possède rien. Entre les deux, 40% de la population, essentiellement occidentale, possède 14% des ressources. On peut dire avec Alain Badiou qu' »un but important de ces 40% est de ne pas tomber dans la masse des 50% qui n’ont rien » (1). On le comprend bien. On comprend moins que cette crainte, légitime, liée à la menace permanente du déclassement implique l’ignorance pure et simple de ces 50% dans nos analyses.
Penser que l’enjeu en France est de reconstruire la conscience d’elle-même du prolétariat est une erreur idéologique fondée sur une incompréhension de transformations sociales fortes. En plus du caractère dramatiquement ethnocentré qu’elle révèle, elle amène à conclure un excellent travail documentaire sur des sottises. Sottises qui nous empêchent de nous poser cette question simple, et qui est pourtant, je crois, la seule valable. Cette question vaut en ce qu’elle se glisse au cœur des nœuds bien serrés du réel. Et cette question est :
Comment parvenir un jour à ce que nous, classes moyennes et supérieures confondues,
nous qui possédons 100% des ressources mondiales,
rejetions
en masse
le capitalisme ?
(1) Alain Badiou est un des rares intellectuels à avoir véritablement tenu compte de ces données, mais sur un tout autre sujet : il l’a fait au demain des attentats du 11 novembre 2015 pour analyser le phénomène, précisément, transnational qu’est le terrorisme.