Jeudi 16 juin
La propriété intellectuelle c’est le vol
Sarga
Jeudi 16 juin
La propriété intellectuelle c’est le vol
Mercredi 15 juin
Mais que c’est beau.
« Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici, j’ai dû le dire. Je sais seulement que j’étais déjà très vieux avant de m’y
trouver. Je me dis nonagénaire, mais je ne peux pas le prouver. Je ne suis peut-être que quinquagénaire, ou que quadragénaire. Il y a une éternité que je
n’en tiens plus le compte, de mes ans je veux dire.
Je sais l’année de ma naissance, je ne l’ai pas oubliée, mais je ne sais pas dans quelle année je suis parvenu. Mais je me crois ici depuis un bon moment. Car je sais bien ce que peuvent contre moi, à l’abri de ces murs, les diverses saisons. Cela
ne s’apprend pas en une année ou deux. Des journées entières m’ont semblé tenir entre deux cillements. Reste-t-il quelque chose à ajouter ? Quelques mots peut-être sur moi. Mon corps est ce qu’on appelle, peut-être à la légère, impotent. Il ne peut pour ainsi dire plus rien. Ça me manque parfois de ne plus pouvoir me traîner. Mais je suis peu enclin à la nostalgie. Mes bras, une fois en place, peuvent encore exercer de la force, mais j’ai du mal à les diriger. C’est peut-être le noyau rouge qui a pâli. Je tremble un peu, mais seulement un peu. La plainte du sommier fait partie de ma vie, je ne voudrais pas qu’elle s’arrête, je veux dire que je ne voudrais pas qu’elle s’atténue. C’est sur le dos, c’est-à-dire prosterné, non, renversé, que je suis le mieux, c’est ainsi que je suis le moins ossu. Je reste sur le dos, mais ma joue est sur l’oreiller. Je n’ai qu’à ouvrir les yeux pour que recommencent le ciel et la fumée des hommes. Je vois et entends fort mal. Le large n’est plus éclairé que par reflets, c’est sur moi que mes sens sont braqués. Muet, obscur et fade, je ne suis pas pour eux. Je suis loin des bruits de sang et de souffle, au secret. Je ne parlerai pas de mes souffrances. Enfoui au plus profond d’elles je ne sens rien. C’est là où je meurs, à l’insu de ma chair stupide. Ce qu’on voit, ce qui crie et s’agite, ce sont les restes. Ils s’ignorent. Quelque part dans cette confusion la pensée s’acharne, loin du compte elle aussi. Elle aussi me cherche, comme depuis toujours, là où je ne suis pas. Elle non plus ne sait pas se calmer. J’en ai assez. Qu’elle passe sur d’autres sa rage d’agonisante. Pendant ce temps je serai tranquille. »
Malone meurt, de Samuel Beckett
Mardi 14 juin
L’expression du moment : « Je suis sous l’eau ». Je suis sous l’eau. Quelle blague.
On ne le dit pas assez mais Rimbaud a passé sa vie à s’ennuyer. Pendant toute son enfance. Sans doute très vite à Paris, lorsqu’il fréquentait l’avant-garde littéraire. Pendant son errance à Bruxelles. Au milieu même de son histoire avec Verlaine. Il faut imaginer Rimbaud mauvais, se disputant avec lui par désœuvrement. Le provoquant sans cesse par des actes cruels, juste parce qu’il désespérait de voir les heures s’étirer dans la sinistre chambre. N’en pouvait plus d’aller d’hôtel miteux en hôtel miteux. De regarder l’autre dans le blanc des yeux et de finir les bouteilles de tord-boyaux. Il avait fait le tour de la vie de bohème. Est parti pour l’Afrique : tuer le temps. Il a vendu des armes. Il a fait du commerce. Neg-otium : brisée, l’oisiveté.
Ça l’a bien occupé. Comme tout. Quelques mois. À quel point ? Au fil de ses transactions se sentait-il parfois sous l’eau ? On ne le saura pas. Le négoce l’a bien occupé mais n’a pas empêché l’ennui de poursuivre son travail. De lui ronger les os. De contaminer son sang. Rimbaud toute sa vie s’est plaint de l’ennui autant qu’il se l’est infligé tel un pénitent sa discipline. Il s’est ennuyé puis lorsqu’il s’est vu mourir, tout grignoté, il s’est dit Non. Pas déjà.
Malgré cette fin tragique, savoir que Rimbaud s’ennuyait me rassure. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il avait raison. Raison de quoi, je l’ignore. Mais il éprouvait chaque jour comme il fallait attendre davantage que ce que la vie nous donne. Non pas la vie : sa médiocre organisation. La bonne intelligence. Il connaissait le vide qu’aucune interaction sociale, aucune occupation ne devrait tenter de combler, car il avait l’intuition – la pré-science – de son exacte inverse. Un jour (ou une nuit) l’avait peut-être goûtée : une extase, indicible.
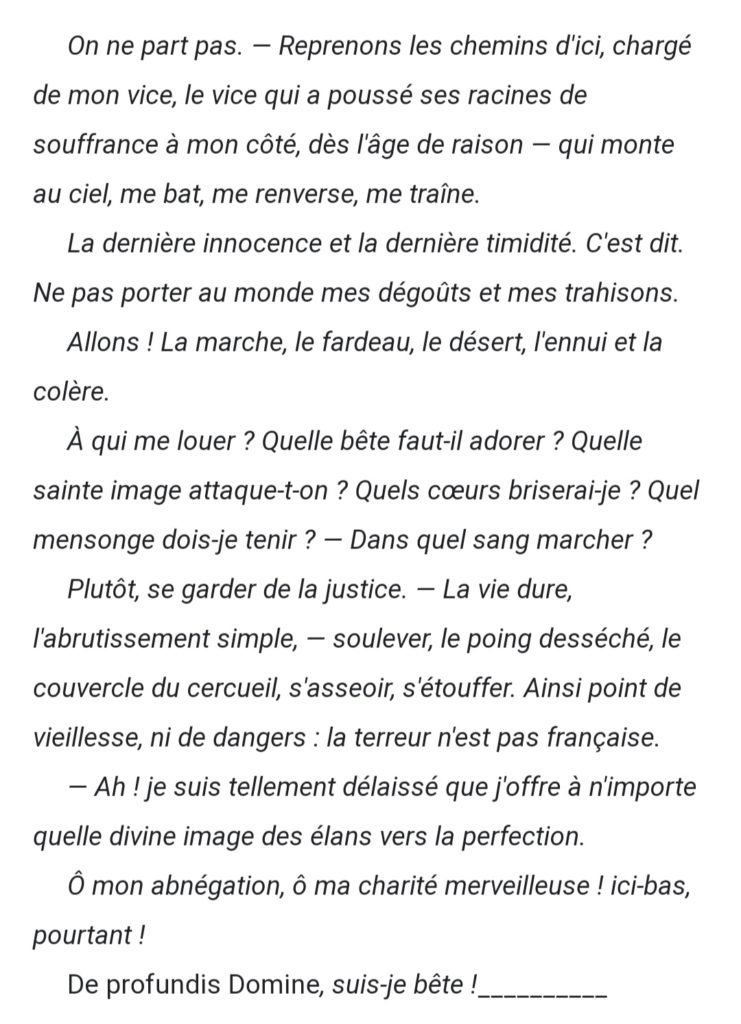
« Mauvais sang », Une saison en enfer, 1873
Samedi 11 juin
De tous ceux que j’ai pu voir ce sera donc Loulou. Voilà un film lumineux, plein d’humour, où l’on sent de manière quasi physique la joie du couple à se retrouver ensemble. Voilà : le bonheur amoureux c’est ici, avec le rire et la déconne, le sexe et l’alcool. Et le partage de tout, absolument : les dangers, les projets, les fous rires, les mégots, le lit, la peau, la salive. « Quelqu’un c’est des heures », écrivait Mathieu Larnaudie dans son premier roman prometteur. Rien de plus juste. Loulou ancre savamment le passage du temps dans la formation du couple.
Comme souvent chez Pialat, le casting est excellent, si ce n’est Guy Marchand qui ne parvient jamais à passer pour un véritable bourgeois, sauf lorsqu’il s’en va, silencieux, avec son grand manteau – cela dit, il n’est pas impossible de considérer ce décalage comme volontaire et par un effet inverse, d’autant plus intéressant. Depardieu et Huppert, actrice dont il faudra que j’évoque un jour la grandeur du jeu, sec et fantasque, nous tiennent jusqu’au bout. Les deux individualités sont à la fois pleines d’elles-mêmes, peut-être même imbues, et parfaitement vouées l’une à l’autre. Leur ajustement est un petit miracle. En outre, là encore comme souvent chez Pialat, les interactions avec de multiples seconds rôles maintiennent l’intensité des situations en dehors de la chambre d’hôtel.


Se trouve enfin une scène mémorable, qui renforce le couple en l’immergeant dans le milieu de l’un des deux, tout en en accentuant l’incompatibilité sociale. Cette tension fabrique du drame. Tout ici est beau et sonne vrai. J’ai bien peu à en dire, il faut juste regarder. Alors, au milieu de la bouffée de vie qu’on se prend au visage, entre l’attaque d’une poule par le chien de la maison et celle, par le beau-frère jaloux, d’un copain invité, la manière dont Nelly, sentant son éloignement soudain, approche de ses lèvres les doigts de Loulou est magnifique. D’une justesse poignante. Dans ce moment aussi doux que cruel, Loulou et Nelly n’apparaissent déjà plus tout à fait comme les deux doigts d’une main. La main et la bouche de l’une sur les doigts de l’autre tentent de retenir l’amour, l’intimité et même s’il le faut l’inquiétude, du moment qu’elle est amoureuse. Cette main voudrait tout garder. Lutter sans mot dire contre l’éparpillement qui précède, inéluctable, une séparation. À son retour à Paris, Nelly se fera avorter.

.
Mercredi 8 juin
Mardi 7 juin
Lorsqu’on analyse une oeuvre, il faut bien veiller à s’en tenir au jugement de l’œuvre seule, et non de son créateur. C’est là la grande difficulté car c’est aussi la grande tentation. Le glissement est facile. Mais il est erroné. Affirmer qu’un film est mysogyne, un texte, abscons, une musique, lanscinante ne dit rien du caractère ni des opinions de ceux qui les ont mis au monde.
Tout d’abord parce qu’on ne doit jamais oublier la dimension expérimentale de l’acte créatif. L’œuvre permet avant toute autre chose d’essayer des formes, formes qui mèneront à certains effets. La réception de ces effets échappe en grande part à l’émetteur. Le récepteur peut trouver des choses que celui-ci ne voulait pas y mettre. C’est ainsi. Il faut l’accepter. Pour autant, aller essayer de discerner telles ou telles de ses pensées, ou pire : de ses intentions, c’est une autre affaire. On entre dans l’intime. On s’occupe de la personne. On outrepasse, en quelque sorte, ses droits, que l’on a pourtant en totalité.
Et puis il y a autre chose. De plus profond, de plus difficile à expliquer, mais qui est peut-être simplement le prolongement du précédent point. Parfois, pour aller au bout d’un récit, au bout des situations que celui-ci déploie, parfois pour les explorer jusqu’à ce qu’il n’en reste rien d’inconnu ni de trouble, il est nécessaire à celui qui les aura fait naître de se laisser promener dans des zones qui ne reflètent pas forcément ses opinions. C’est plutôt qu’il ne pouvait en être autrement. L’écriture se fige en fatalité. L’auteur voudra alors plaider : mais c’est exactement ce récit-là qu’il fallait ! Ce récit, avec ses directions morales ou politiques qu’on ne pouvait esquisser. Plaisantes ou non.
Il était sans doute inévitable que Lolita soit lu comme une défense de la pédophilie, même si Nabokov comptait au contraire y montrer le parti de la jeune fille. Pourquoi inévitable ? Parce que l’écriture du livre contenait en elle cette dimension sulfureuse et peu reluisante. Parmi toutes ses facettes, elle contenait ce qui n’avait jamais été formalisé avant. Un point de vue inouï. Cette formalisation/invention pouvait bien se faire au prix d’un malentendu entre le lecteur et l’écrivain : il fallait de toute manière qu’elle ait lieu. Là encore c’est ainsi. Mais plus gênant en revanche, beaucoup plus problématique eût été de prêter à l’auteur cette volonté de défendre l’indéfendable par souci subversif ou par perversité personnelle et de le faire via son écriture, sa langue. L’écrivain s’il est bon n’est jamais militant.
J’affirme ceci, cette nécessité de couper le texte de son auteur avec d’autant plus de feu que le roman sur lequel je travaille m’amène là où je ne serais jamais allée par un simple raisonnement. Le récit, son incarnation me tirent par la manche. Et voilà, l’entrelac narratif pourrait tourner droitard. Moi je suis de gauche radicale et je vois bien à quel point il s’en fout.
Lundi 6 juin
« Il aurait dû être l’un des meilleurs peintres de sa génération. Mais il s’y est mis trop tard et s’est précipité trop vite. Comme dans tout ce qu’il fait. Comme quand il a voulu être pasteur et puis tout le reste… Puis il a pas appris.
Je comprends pas ce que fait Vincent. La vérité tout au fond c’est que… la vérité tout au fond c’est que j’aime pas sa peinture. Je voudrais qu’il peigne comme Renoir. Alors là ça me paraîtrait bien. Non c’est pas vrai d’ailleurs, s’il peignait comme Renoir j’aimerais pas ça non plus. J’aimerais pas ça non plus s’il peignait comme Renoir. Mais tu vois si Renoir peignait comme Vincent, alors là j’aimerais ça du moment que c’est pas Vincent mon frère qui l’a fait. Tu comprends ?
– Tu dis n’importe quoi. Tu cherches toujours à découvrir des mystères. Ya seulement la façon dont la vie se passe, c’est tout.
– Tu veux que je t’aide à te rincer ?
– Oui ! »

« C’est la poule aux œufs d’or, hein. T’as les toiles du plus grand peintre de notre époque et t’en fais rien. […]
J’ai l’impression d’être entretenu et ça, c’est le comble. J’aurais mieux fait d’être docker à Marseille.
– Enfin tu sais très bien qu’on peut pas peindre si on travaille. Tous ceux qui ont essayé ont dû arrêter de peindre.
– Gauguin a peint plusieurs années en restant agent de change.
Quand même tu m’as étouffé. Si j’avais travaillé plus fort j’aurais fait de bien meilleures choses, je le sens bien j’ai rien fait d’important.
Et puis c’est trop triste. J’arrive au bout du rouleau. T’as rien remarqué ces derniers temps ?
– Non.
– Ce que je peins ne vaut plus rien, de la merde. T’as vu le portrait de Marguerite Gachet ? Un tas de boue.
– Écoute c’est un moment de transition […] On ne peut pas toujours être au sommet…
– Au sommet !… T’as jamais aimé ce que je fais. Ah de temps en temps un mot, une phrase de pure convention mais tes goûts à toi je les connais. »
(Van Gogh – les deux meilleures scènes, avec celle de la nuit au bordel)
Dimanche 5 juin

« Je ne concours que lorsque je suis sûr de gagner. » (ce jour, un drôle d’ami, autonome, bienheureux et fin stratège)


Samedi 4 juin
Vu À nos amours. Étonnée de la grande tristesse qui domine ce film, déjà contenue d’ailleurs dans son très beau titre. Je ne comprends pas pourquoi il est si triste. Quelle sombre énergie le meut, ni quel soubassement moral ou existentiel en a déterminé le ton. Il parle d’une jeune fille assez libre, qui à plusieurs reprises fait remarquer à ses parents séparés qu’il faut penser à soi, se faire plaisir ; d’une jeune fille qui se laisse aller à son désir et revendique une forme d’égoïsme. Pourtant, tout dans cette histoire suinte la tristesse, l’impuissance et la désillusion. Suzanne, surtout, semble subir ses propres comportements. Elle se dit malheureuse.
Car elle couche avec les hommes qu’elle vient à rencontrer tandis qu’elle sèche ses cours et sort le soir, mais ne peut rester avec celui dont elle est amoureuse. Comment l’expliquer ? Certes, on pourrait toujours décider de prendre le personnage comme il est, sans véritable psychologie. Suzanne serait selon son père incapable d’aimer, point. De fait, pas grand-chose nous la rend sympathique (ce qui, en soi, n’est pas un problème cinématographique). Disons que Suzanne est une adolescente parfaite. Une ado parfaitement jouée. Néanmoins un contexte familial précis nous est donné, et en détail. Difficile de ne pas voir là une invitation à l’analyse. Voici ce que celle-ci nous donne :
1) Suzanne adore son père (dit plusieurs fois), et réciproquement
2) sa mère, qu’elle déteste, est fragile, peut-être folle
3) son frère adule sa mère (et réciproquement)
On a là un schéma psychanalytique on ne peut plus classique. Suzanne semble engluée dans le complexe d’Oedipe et ne parvient pas à aimer les hommes convenablement. Ceux qu’elle estime lui restent interdits (Luc, comme son père – notons que c’est Pialat lui-même qui s’est attribué ce rôle) ; alors elle multiplie les aventures avec d’autres, qui ne comptent pas.
Si on ajoute à cela une éducation aux valeurs traditionnelles (une jeune femme doit arriver vierge au mariage), et surtout une tendance au sein du même foyer à se taper dessus (de la simple gifle à des coups plus violents), on saisit tout le poids du malheur que traîne la jeune héroïne. Penser, froidement, qu’il faut jouir de la vie comme le fait Suzanne ne suffit plus. Les impasses du milieu familial la rattrapent invariablement. Même les fêtes entre jeunes semblent sinistres. Telles des soirées inversées ou bien les restes glauques de celles de la libération sexuelle de la décennie précédente. Ici, sous une légèreté de façade les relations pèsent des tonnes, nulle joie ne s’en dégage. Les scènes dans les lits sont toujours esquivées. Heureusement, on entrapercoit de temps en temps les seins de Sandrine Bonnaire ou un corps masculin allongé. Mais le tout est produit par dépit. Sans sualité. Il n’y aurait décidément rien à sauver dans la débauche.
Or on est en droit de trouver ce schéma narratif critiquable. Un brin réactionnaire : pour le même prix, Suzanne pouvait être heureuse. Oui mais voilà, papa est trop fort, et une sexualité débridée ne peut être que le signe d’une blessure profonde. Enfin, l’incapacité à vivre et faire l’amour avec l’être qu’on aime parce qu’on l’aime trop, est, disons-le, un sacré cliché ; en tout cas davantage une problématique masculine. Sur ces points-là le récit me paraît un peu douteux.
Certains dialogues du film sont très bons, mais pas tous. Enfin, les disputes familiales, aussi réalistes soient-elles (je sais que Maurice Pialat laissait longtemps tourner sa caméra pour voir les acteurs arriver à certaines extrémités. Ainsi, après des heures de promiscuité passées dans le but d’inventer du vrai, de produire quelque chose en reproduisant des parcelles de vie, la frontière entre jeu et réalité s’en trouve brouillée) frôlent l’hystérie collective. Un peu comme dans les films de Cassavetes, la mysogynie en plus. Le rôle de la mère est ainsi particulièrement ingrat. Sans parler du frère, dont il est sous-entendu qu’il a choisi de cacher son homosexualité pour se marier avec une femme riche et influente dans le but de faire carrière.
Pour autant la force du film n’est pas à remettre en question. De chaque scène se dégage une grande intensité. En le voyant j’ai pris la mesure de ce que des réalisateurs comme Bruno Dumont, ou même Arnaud Desplechin revu récemment lui devaient. Intérêt donc, mais partiel. Le film est malgré tout trop amer, rembruni. Quasi atrabilaire.
En revanche du Garçu il faudra retenir les scènes, toutes magnifiques, entre Gérard et le petit Antoine. La façon qu’a ce père de crever d’amour pour son fils, ses gestes étouffants, comme générés par bouffées d’affection, sont poignants.
Cette fois c’est le personnage masculin qui n’est pas épargné, même si l’on pourrait considérer le départ de sa femme comme le résultat de sa faiblesse et de son incapacité à s’accommoder d’un homme au caractère bien trempé – le personnage de Gérard montre de gros défauts, mais aussi une puissance individuelle hors norme. Je trouve cet homme plutôt aimable, alors pourquoi ne le serait-il pas également aux yeux de Pialat ? Sophie, elle, lui préférera un homme plus effacé, plus féminin et plus gentil ; peut-être plus enfantin puisqu’il prend un chocolat chaud pour son goûter quotidien et refuse d’aller chez le dentiste.
Il est possible que je garde quelque chose de ça, cet attachement mal dosé, pour l’un de mes personnages. Cependant, on peut sérieusement douter que le papa mordu de sa progéniture dans Le garçu le fût tout autant s’il n’en avait pas été séparé. Son amour démesuré vient aussi du sentiment de dépossession. Mon personnage, lui, vit avec son fils. Il se coltine le quotidien d’un père présent.
Vendredi 3 juin
La diffusion des films de Maurice Pialat est une merveilleuse occasion de parler de Depardieu, acteur dont j’ai déjà évoqué le talent dans un billet précédent mais jamais le dos. Car c’est peut-être ce qu’il a, avec sa gueule et sa voix, de plus singulier, de plus marquant et de plus beau dans nombre de ses films : ce dos large, épais, légèrement voûté, et tombant en toboggan inversé jusqu’au niveau des reins. Un dos qui le fait avancer quels que soient la scène et le récit, comme implacable, sans le moindre flageolement. Lui donne l’allure d’un bulldozer et celle d’un animal. Dans ces films-là, dont Le garçu, ce dos paraît aussi puissant qu’harmonieux.

Or c’est d’abord de ce dos que vient à Depardieu cette incroyable présence au monde. Du dos d’abord, bien avant une supposée assurance « naturelle ». Car le corps est seul à faire le caractère, si bien que l’on peut affirmer que l’état d’esprit est toujours un état du corps. Nos traits ne sont rien d’autre que chair, os et nerfs.

Pour Depardieu, ce seront les dorsaux, chez lui très tôt voûtés, qui lui feront tenir ses grandes mains vers l’avant et si bas. Ils les rendent un peu molles, presque pataudes, simiesques, sauf lorsqu’elles tiennent une cigarette et remontent vers la bouche pour qu’elle tire une bouffée. Ce sont ses dorsaux aussi qui lui font tenir sa tête comme mettant au défi, mais avant toute autre chose pour empêcher celle-ci de plonger vers le sol. Le visage doit lutter pour regarder le monde, alors le menton carré en se relevant prend un air d’engagement.
C’est enfin la courbe du dos, tandis que celui-ci se plante de biais en plein dans les hanches, qui libère ses jambes du poids si imposant du torse. Chez Depardieu haut et bas sont séparés. Les jambes peuvent se mouvoir aisément. Droites sur toute la longueur, sans jamais s’avachir. Dans la marche le flanc s’ouvre, le genou tire vers l’extérieur. Les jambes se détachent de l’avant ventripotent. Elles semblent prêtes à partir pour aller danser la gigue. Ailleurs, sans lui.
