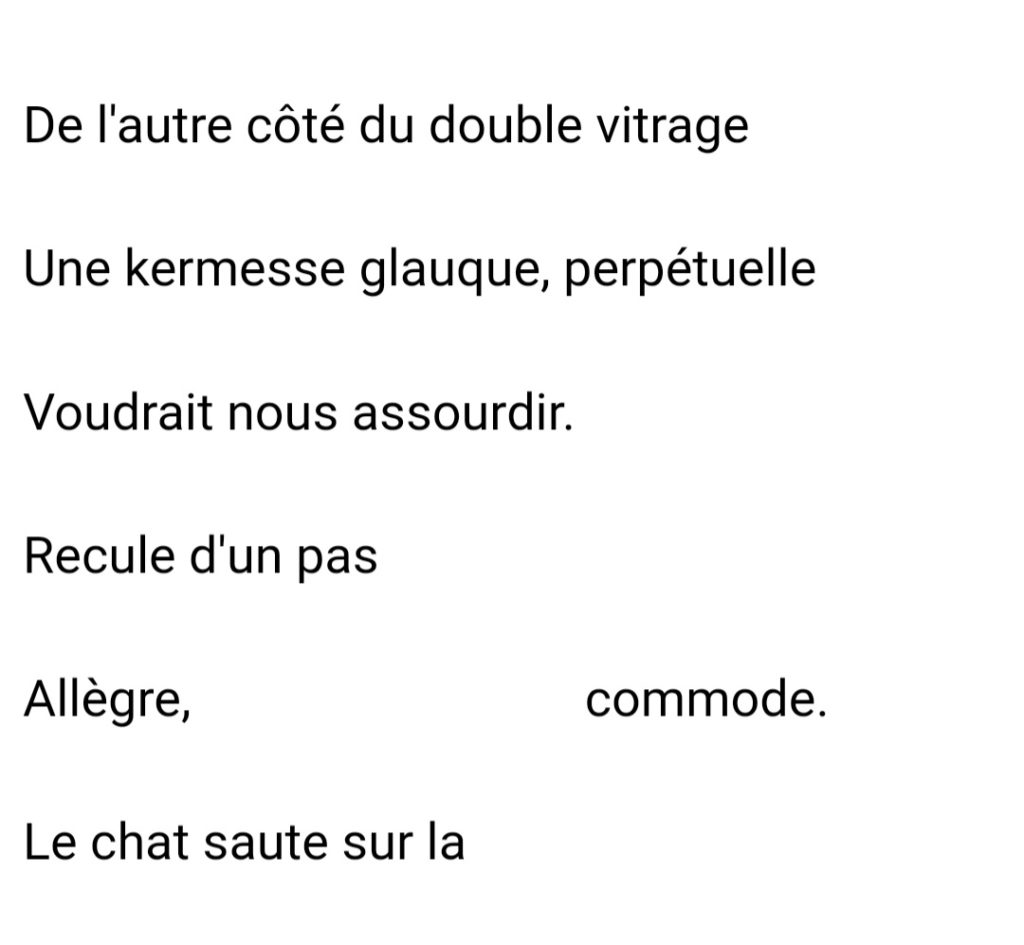Mercredi 1er juin
Sa sœur Nadège arrivait, elles déjeuneraient quelque part. J’étais le bienvenu. Acceptai l’invitation. Le week-end commençait, je n’avais rien à faire de particulier et je me sentais bien, bien avec Élo. Je pris donc à mon tour un café puis allai me préparer. J’entrai guilleret dans la salle de bains, fermai la porte et me douchai. Je prenais mon temps sous l’eau chaude, m’amusais des produits en en testant certains, tous si délicieux, si exotiquement féminins. Shampoing à l’huile d’argan. Gel douche spécial peaux sèches à l’extrait de rose bio d’Équateur. Gommage aux noyaux d’abricot. Gant de crin biface, comme mes éponges. Après-shampoing restructurant tilleul-hibiscus. C’était un festival de parfums. L’un chassait l’autre. Une fois seulement que j’arrêtai l’arrivée d’eau et attrapai une serviette, des voix étrangement proches parvinrent à mes oreilles humides. Je remarquai en effet que le son arrivant d’une autre pièce, probablement de la cuisine, probablement par les bouches d’aération, ressortait dans la salle de bains : comme si on y était. Aussi clairement, aussi fort. Élodie faisait la vaisselle de la veille et mettait de l’ordre sur le plan de travail. Tasses et cuillers tintaient. L’eau de l’évier coulait par à-coups et allait circulant dans les tuyaux. Je commençai à me raser. Me retins de chanter. J’avais acheté tout le matériel nécessaire quelques semaines auparavant et laissé bien en vue sur l’étagère au-dessus du lavabo, avec ma brosse à dents. Non sans plaisir, sans prévenir Élodie mais le tout disposé comme pour faire une surprise ou bien plutôt un test. Plus tard à la découverte du matériel deux émoticônes m’avaient été envoyés. Je les avais reçus dans le tramway pour le bureau. L’un tendre, l’autre moqueur. L’idée que j’étais en train de m’installer chez elle tel un coucou me réjouissait. Mais au milieu de ces pensées soudain je fus troublé : juste à côté avait lieu quelque chose d’anormal. La conversation semblait se raidir. Je tendis l’oreille à nouveau tout en passant le rasoir sur ma joue. Et alors que j’essayais de comprendre de quoi parlaient les deux femmes, constatai que chaque tapotement sur le lavabo, chaque tintement de la faïence contre l’évier, chaque écoulement aussi bref fût-il de l’eau tant pour rincer la vaisselle là-bas qu’ici pour nettoyer la lame était un obstacle à ma compréhension. Je jubilais du concours de circonstances – moi, seul dans une salle dont la VMC faisait caisse de résonance des sons produits depuis une pièce voisine – qui me permettaient d’entendre une conversation intime ; et tout autant pestais de ne pas être en mesure d’en saisir chaque mot. Les voix étaient dures à distinguer. Je rageais plus encore d’être en grande part responsable par mes propres gestes de la perte acoustique. Responsable et victime. Pire, maintenant que j’avais commencé à émettre les bruits réguliers de mes soins d’hygiène, je craignais que m’arrêter soudain n’attire l’attention. Après tout, rien n’interdisait que je les entende aussi bien qu’elles moi. L’histoire ne le disait pas. C’était à envisager. Si je voulais continuer à jouir de ma position d’auditeur interdit, je ne devais éveiller nul soupçon en cherchant à me faire oublier. Par conséquent, dans l’éventualité où je serais entendu, le plus difficile pour moi devenait désormais de ne pas surjouer le rituel de la toilette. Il fallait faire du bruit mais ni trop, ni trop peu, ni trop régulier, ni par trop chaotique, étouffé ou ostentatoire. Feindre le naturel, par pure précaution. Cependant je me disais à la fois que si Élodie et Nadège m’avaient entendu distinctement de là où elles se tenaient, d’elles-mêmes elles auraient évité de se disputer. Pour revenir au calme auraient changé de sujet. Or c’étaient bel et bien les signes d’une dispute que je percevais à présent. Pour en savoir plus je me concentrai pour bouger et produire quelques sons juste entre deux phrases. Dès que je sentais venir une pause ou une hésitation, un changement de locutrice : tchac. Tout en prenant aussi soin de temps en temps de me racler la gorge ou me rincer les dents au beau milieu d’un mot. À ce moment précis, je remarquai qu’Élodie, enfin ce que je pensais être elle interrompait Nadège de plus en plus souvent. Elle semblait mener l’assaut. Si bien que ses prises de parole me prenaient au dépourvu à un rythme croissant. Je tentais de faire du bruit quand l’une parlait mais les sons sortaient quand l’autre prenait la parole. Et inversement. Ou alternativement. De même, alors que je guettais toujours dans leur voix une courte halte, mon tapotement, frottement et mon reniflement tombaient invariablement au milieu d’une proposition. Dans ces conditions je ne parvenais que trop rarement à émettre de manière efficace. Captais pour finir assez peu de phrases entières et encore moins d’échanges significatifs entre les sœurs. Dans le désordre sonore et vibratoire issu de l’irritation que je sentais monter en elles comme de mes propres mouvements, devenus gauches, voire incongrus et manquant leur effet, je ne laissais pas de m’étonner. Cela ne lui ressemblait pas. Élodie était vive mais jamais impatiente. Et brutale sûrement pas. Énergique certes mais toujours respectueuse de l’opinion d’autrui. Ici pourtant, son ton n’avait rien d’équivoque : il était d’une aridité que je ne lui connaissais pas. Était-elle bien elle ? Était-elle celle que je croyais entendre parler ? Mon étonnement, par ailleurs, ne faisait que croître avec le contraste des deux tonalités. Tandis que sa soeur mordait la voix de Nadège se faisait plus plaintive. Tendance geignarde. Elle ne pleurait pas mais comme mimait les pleurs. Et pour ajouter du crédit à son attitude, le mot triste revenait tout le temps dans sa bouche. Toutefois, hormis ces quelques éléments plutôt explicites finalement je n’étais sûr de rien. Pour couronner le tout, je me retrouvai tellement concentré sur le rythme des phrases dans l’espoir d’y glisser un gage crédible de mes occupations que je manquai le sens de plusieurs. Bien que complètes et parfaitement audibles. Je finis par perdre patience. Puis je me résignai. Je n’entendrais pas tout ce que je voulais entendre. Entendrais peut-être ce que je ne voulais pas. Sortis de la salle de bains. Un peu moins gai, rasé de frais.