Lundi 10 octobre
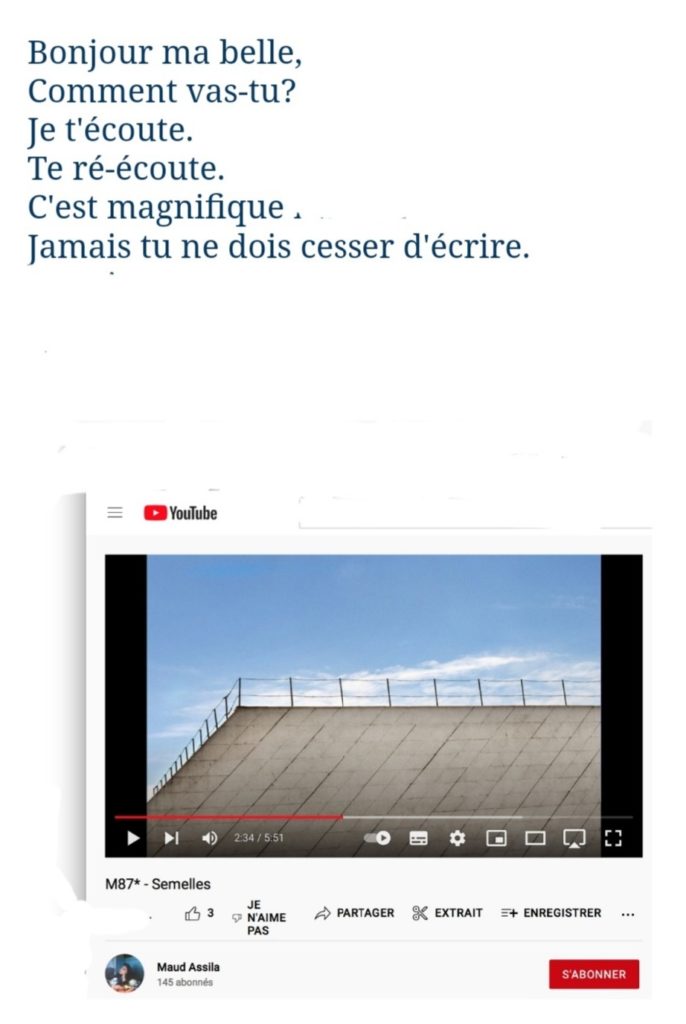
Sarga
Lundi 10 octobre
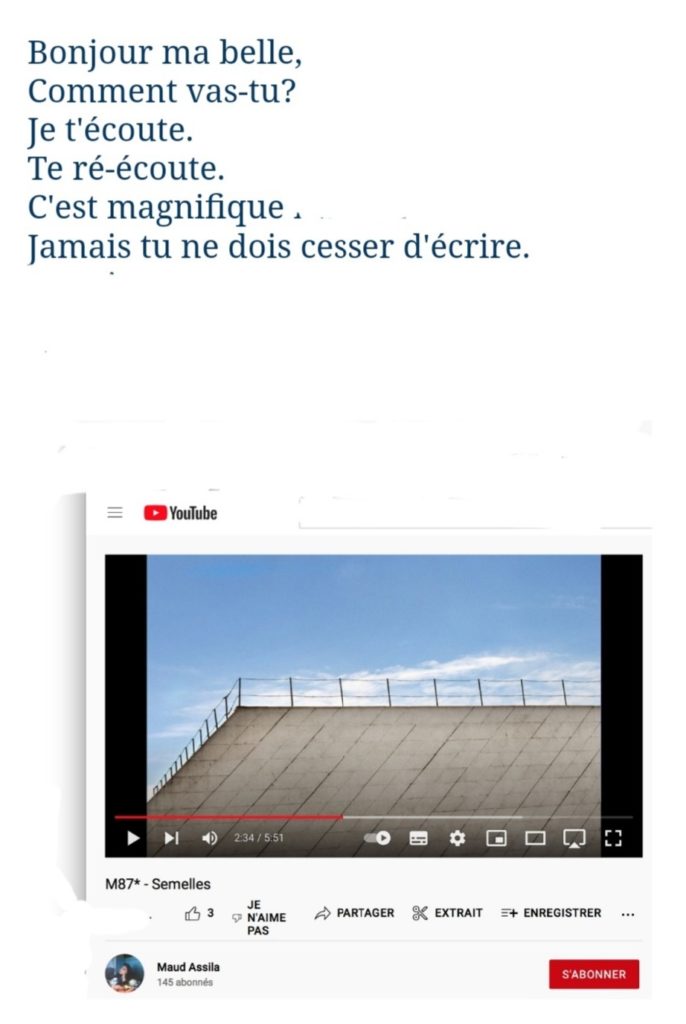
Vendredi 9 septembre
Lorsque je me plains – car cela peut m’arriver, par mégarde – de ne pas avoir de lecteurs, mon ami me rappelle qu’il ne peut en être autrement. « Ce que tu fais, c’est comme aller tous les dimanches punaiser un nouveau billet sur le mur de la salle communale », m’a-t-il dit l’autre jour.
J’adore cette phrase. L’image est parfaite de vérité. C’est effectivement une volonté délibérée de ne pas faire la publicité de mes publications. J’ai suffisamment pratiqué l’autopromotion pendant ma période militante pour savoir comme la question de l’audience (de la visibilité) tronque la manière de penser et de dire. Écrire en ayant en tête ses lecteurs condamne à chercher d’abord à les séduire. On pourrait dire dans ce cas : écrire à quelqu’un c’est tromper. Or je ne veux séduire personne. Je veux aller au plus juste. Au plus près de ma propre pensée ; observer mes états (du corps, car il n’y a pas d’idées, mais seulement des états du corps), dans et par ma réception des œuvres des autres.
L’absence de lecteurs – l’absence, à vrai dire, du moindre encouragement, mais pourquoi diable devrait-on m’encourager ? – ne saurait être l’unique raison de la réduction de mes publications. Je crois de toute façon qu’en matière d’écriture, que l’on soit célèbre, reconnu, mauvais, talentueux, populaire ou isolé, discret, besogneux, modeste et même hyper arrogant, au bout du bout l’on se retrouve toujours seul ; avec ses phrases ; avec les mots. Seul à triturer.
Je le sens déjà. Toutes ces considérations sont bien jolies. Mais elles s’avèrent de peu de poids face aux faits. Or les faits ici sont limpides : ces dernières semaines le sport a pris dans mon quotidien une place bien plus importante que la lecture et l’écriture réunies. Écrire n’est absolument plus une priorité. Je n’y suis plus. Je suis ailleurs. Quand j’ai du temps je vais courir, sauter, soulever. Me triturer la matière. L’éprouver. Rien d’autre. Je ne me suis jamais autant amusée.
Voilà. Ce ne sont pas les changements que j’attendais en début d’été, mais c’est bien avec ce réel qu’il faut composer. Et je fais plus que m’en satisfaire : je m’en réjouis. Il est possible que je continue à publier encore un billet de temps en temps, car l’art et les procédés de création n’ont évidemment pas fini de m’intéresser. Mais le rythme ne sera plus le même.
Toutefois, j’ai bien envie de rassembler dans le blog les passages du roman inachevé que j’ai écrits tous ces derniers mois. Ce sera donc l’équivalent de quelques dizaines de pages, laissées à l’abandon. C’est mon côté Céline. J’aime bien l’idée que des heures d’écriture se tiennent là, en l’état, à portée de clic et de vue de n’importe qui. Quant à moi j’irai faire du sport jusqu’à plus soif et un jour peut-être j’y reviendrai pour finir le travail.
Mercredi 13 juillet
Reprise du blog prévue le 1er septembre, si tout va bien avec quelques nouveautés.
En attendant, silence (ou presque).
Mardi 28 juin

Note pour Trois cafés (?) : expliquer – raconter – en quoi l’enchaînement des exercices sportifs crée les conditions d’une méditation. Refuser ainsi l’idée qu’il y aurait une pratique noble de la méditation, noble parce que 1) ancestrale et 2) immobile, et disons « le reste », c’est à dire le sport.
Recommencer les mêmes exercices et créer une fatigue du corps par l’ennui produit un état singulier de flottement, d’absence à soi et/ou au monde. Un état alterné quoique parfaitement conscient. J’écris « par l’ennui » et non « dans » ni « avec », car c’est précisément l’ennui qui provoque l’altération : l’exercice physique est difficile et ennuyant (pénible, aux deux sens du terme). L’esprit ne veut pas poursuivre, il ne cesse de demander au corps de s’arrêter. Mais bientôt on (mais quoi dans ce on ?) réalise que c’est moins la difficulté physique que cet ennui qui domine. En réalité le corps a vite pris le rythme de l’effort, un rythme de croisière, il ne souffre pas autant que ce qu’il croit, et dans ce relatif confort, c’est bien l’idée de continuer indéfiniment, la conscience que ça pourrait durer encore longtemps, ces conneries de pompes, de course et de squats, qui prend le pas.
Alors seulement, si l’on est bien disposé. Si quelque chose en soi veut bien entendre aussi le plaisir né de la décharge automatique d’hormones et de la chaufferie des muscles. Alors l’esprit finit par se mettre en retrait. Comme en sourdine. Le refus rétrécit, l’esprit est recouvert par le corps. Étouffé. Et au milieu même du bruit à la fois affreux et entraînant (indispensable adjuvant) de la sono, un silence, une sorte de silence, une sorte de silence en soi peut s’installer. Ce qui se passe là et que j’essaie de décrire n’est pas autre chose que ce qu’un sportif, de son côté, appellera « travailler le mental ».
En quoi ce sportif-là diffère-t-il du bouddhiste zen qui, assis directement au sol avant le lever du jour, le dos tenu droit pendant des heures par sa seule volonté (et dans certains monastères, par quelques coups de bâton), l’esprit ankylosé par de rares et réguliers éclats de timbale dont le son se diffuse et résonne dans la salle, fait taire le flux de sa pensée ?

En rien, bien sûr, si ce n’est par l’esthétique qui le porte. Deux ou trois points encore doivent être élucidés : je dois poursuivre la réflexion mais surtout l’observation. Mais j’ai déjà un premier élément. En toute logique, c’est ainsi sur le mélange des régistres esthétiques – noble/ignoble, mystique/ trivial, paisible/affolé, sobre/fluo, intro/extraversion – qu’il me faudra jouer dans le texte pour faire saisir cette communauté de nature.
Dimanche 26 juin
Je reviens sur le billet d’hier. Écrit parce que je ne parviens plus à lire un article de journal sans avoir le sentiment qu’il s’inscrit dans une toile narrative, une série de séries qui se tissent jour après jour, ou plutôt heure après heure – les Unes des sites d’actualités changeant plusieurs fois par demi-journée. Quel que soit le sujet persiste cette même impression, celle d’un feuilleton entretenu. Ici la séquence sans fin des élections françaises ; là l’invasion russe, ou plus exactement la résistance menée par Zelensky ; là encore, les désertions polissées de jeunes diplômés des grandes écoles (Greta est passée de mode) ; là enfin, les accusations de violences sexuelles ; telle péripétie prenant l’ascendant sur les autres en fonction de sa puissance émotionnelle.
J’ai réussi à m’en amuser sincèrement hier, pour un sujet dont on ne sait plus s’il est léger ou non. Mais la sensation n’est pas toujours aussi plaisante : par son ton, sa courte vue, sa découpe grossière, son inconséquence, le journalisme déréalise le réel. Or, la vie politique s’est pleinement adaptée à ce système d’affichage. Les deux – journalisme, politique – se répondent. Se nourrissent. Se confondent. Chacun y a trouvé son compte. Le résultat est une pauvreté analytique absolue. C’est terrible, parce que les deux disciplines sont censées, précisément, coller à la vie. L’une en rendre compte et l’autre la changer, ou l’organiser. Mais on a affaire ici à un simple ping-pong qui jamais ne s’arrête, un jeu mené en vase clos et dont la bêtise extrême finit par imprégner notre imaginaire même et réduire nos attentes. Seulement voilà : je ne me suis pas encore complètement faite à l’idée de tomber sur Plus belle la vie quand je clique sur un titre du Monde.
Ce constat est l’occasion de revenir sur le film France. J’avais conclu à sa sortie sans développer davantage que Bruno Dumont avait alors manqué son sujet. Le problème, en effet, du journalisme n’est pas, ou plus, sa recherche constante du sensationnel. Cette lecture du cinéaste arrive en retard d’une bonne génération. De ce point de vue, les anachronismes dans le film pullulent. Soyons clairs. Il n’y a plus grand-chose qui soit encore susceptible de nous remuer. Et si le spectacle de migrants sur un bateau, pour reprendre une scène du film, était à ce jour capable de faire exploser l’audimat au point de retourner l’opinion en leur faveur, à vrai dire je pourrais m’en satisfaire.
Concernant les médias contemporains, le mal est en réalité plus profond, plus grave (au sens étymologique du terme : lourd, ancré). À la décharge de Dumont, il est sans doute aussi plus difficile à pointer dans un film et à rendre visible. Faire du traitement médiatique un maillon de la société du spectacle ne suffit plus. Ces dernières années on a passé un cran. Le problème, notre problème est ce qu’il faut bien appeler l’incapacité des journalistes à penser. Ils transforment la vie et son foisonnement en bouillie sans mémoire. S’en contentent. Alors donc, rions des petits tracas individuels des personnages linéaires qui croient décider de notre quotidien, cheffaillons d’état, de partis et d’opposition. Prenons-les pour ce qu’ils sont : des fictions divertissantes.
Ce billet par la suite m’a amenée à réfléchir à mes « vieux démons », ou plus modestement l’une de mes marottes, à savoir la méfiance presque viscérale que j’éprouve, précisément, envers tout récit. Ainsi serais-je tentée, dans un réflexe commode, de décréter que le drame dans toute cette affaire réside dans une tendance communément partagée à vouloir faire partout et pour tout du récit – comme lorsqu’on nous ressort à chaque augmentation du taux d’abstention que la France manquerait d’un récit national fédérateur, propos que je déteste pour la… pauvreté de la pensée qui le produit.
De même, en politique, on sait quelle part démesurée a pris le storytelling ces dernières décennies. Il y a désormais une règle simple dans le milieu politique : tu cases ton storytelling sur twitter (240 signes, tout de même) et tu feras le buzz. Et s’il le faut, répète-le en boucle. Tout cela va ensemble : la narration, par l’affect qu’elle génère, nous berce. Elle endort notre sens critique. C’est sa grande force. Pour cette raison je m’en méfie.
Je dois pourtant me méfier de ma propre méfiance. M’obliger à le faire. Car il est aussi tout-à-fait possible de créer des histoires complexes. Il faut garder en tête ce fait simple et indubitable. Ce n’est pas vrai, tout récit ne tire pas vers le bas. Pour ne pas l’oublier la littérature est un bien précieux. Un refuge de l’esprit qui au lieu de le bercer, le réveille bel et bien. Ce n’est donc pas la tendance « naturelle » ou spontanée des êtres humains à faire récit de tout bois qui est à remettre en cause, mais bien plutôt leur paresse. Une paresse intellectuelle semblant parfois, disons, un puits sans fond. Je crois que c’est là le fléau qui est capable de me rendre le plus triste, lorsque je ne suis pas d’humeur à en rire, avec la destruction du vivant. Mais à bien y réfléchir, les deux – négliger la pensée, mépriser la vie – s’avèrent une seule et même chose.
Dans un prochain épisode (!), et pour prouver à mes lecteurs que je ne suis pas seulement une réac qui passe ses dimanches à fustiger l’époque, je raconterai comment, sur les réseaux sociaux, j’ai trollé une professeure qui déplorait le manque de maîtrise de la langue, de la grammaire et de l’abstraction – et donc, cela va sans dire, l’incapacité à penser correctement – des « jeunes-d’aujourd’hui ». La pensée, nous devrions le marteler, ce n’est pas uniquement la langue écrite, mode d’expression qui fut accaparé, tel un capital financier, dès son invention par des commerçants et propriétaires terriens mésopotamiens, par une seule catégorie, la plus aisée bien sûr, de la population. Et il faut croire sans réserve non seulement en l’intelligence humaine, mais encore en la multiplicité de ses formes. Comme quoi, moi aussi lorsque la pulsion me prend je sais utiliser les outils de mon temps et en faire l’usage pour lequel ils ont été créés.
Samedi 25 juin
Épisode 528 : Emmanuel saura-t-il gouverner le pays ?
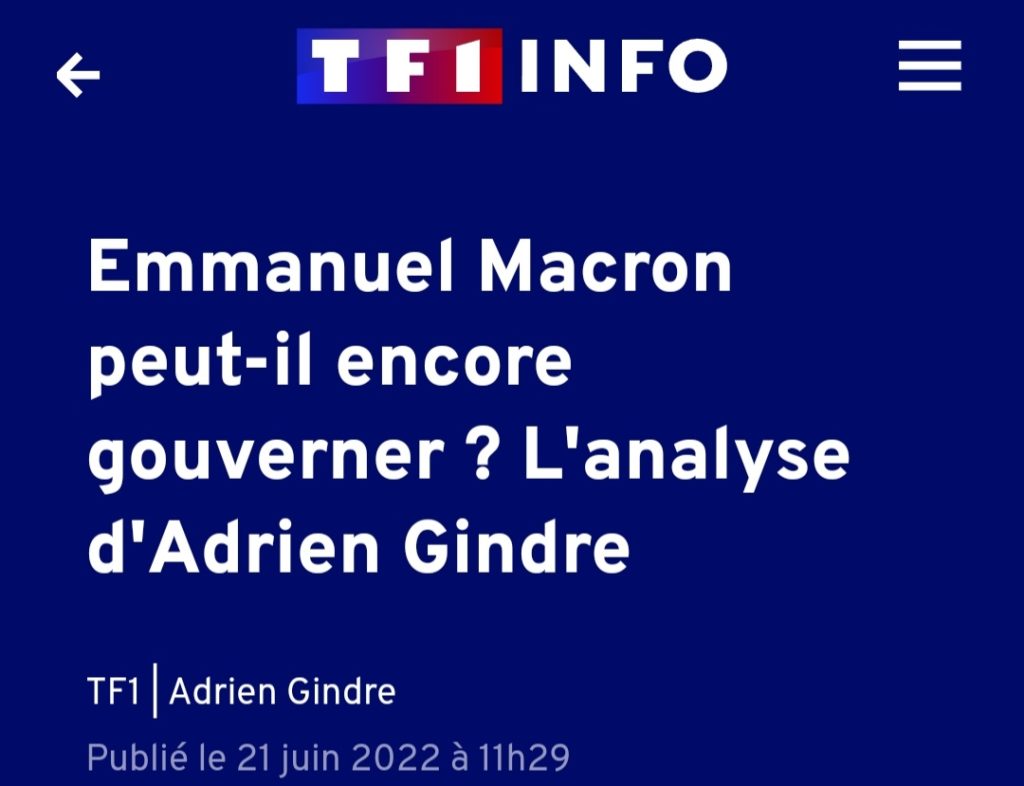
Résumé des épisodes précédents :
Depuis qu’il a perdu la majorité absolue, Emmanuel n’est plus le même. Hésitant, presque fébrile, il semble incapable de prendre des décisions fermes. Cela fait des semaines que le chaos menace. À présent le pays entier est à l’arrêt.

Emmanuel semble avoir perdu son cap. Il a beau avoir reçu la terrible Marine pour sceller avec elle un pacte secret – républicain bien sûr – que la perfide s’est empressée de révéler au grand jour, il sait que rien ne sera plus comme avant.

Et il a raison. Tapi dans l’ombre, on peut craindre que son pire ennemi Jl n’ait de cesse de fomenter de nouveaux complots pour le faire tomber et avec lui, la démocratie toute entière. Souvenons-nous. Déjà, pendant la campagne présidentielle, Jl avait montré son vrai visage en dévoilant son projet diabolique : régner par la division et semer l’anarchie. Désormais sans mandat ni poste à briguer, comment compte-t-il agir ? Nul ne saurait le dire. Une seule chose est sûre : si rien n’est fait pour le contrer, la terre pourrait bien finir par s’ouvrir sous nos pas.

Christian quant à lui fera chanter le petit banquier autant qu’il lui sera permis de le faire. Non par calcul froid et tactique : Emmanuel lui donnait déjà tout ce qu’un homme de droite pouvait espérer depuis bien longtemps. Plutôt par goût du pouvoir et de l’humiliation. Pour le simple plaisir de le voir à genoux.
Et comme si les ennemis ne suffisaient pas, ses propres amis causent eux aussi à notre héros les plus grands tracas. Édouard P, tour à tour débauché, serviteur zélé puis répudié sans précaution, a retrouvé depuis le tremblement de dimanche un peu de sa superbe. Car l’homme à la barbe précocement blanchie veut sa revanche. Il n’oubliera pas comme Emmanuel se montra méprisant et ingrat le jour où il l’a licencié de sa boîte. Les anciens frères sont devenus rivaux. Édouard compte les jours. Il a repris espoir : son heure viendra.
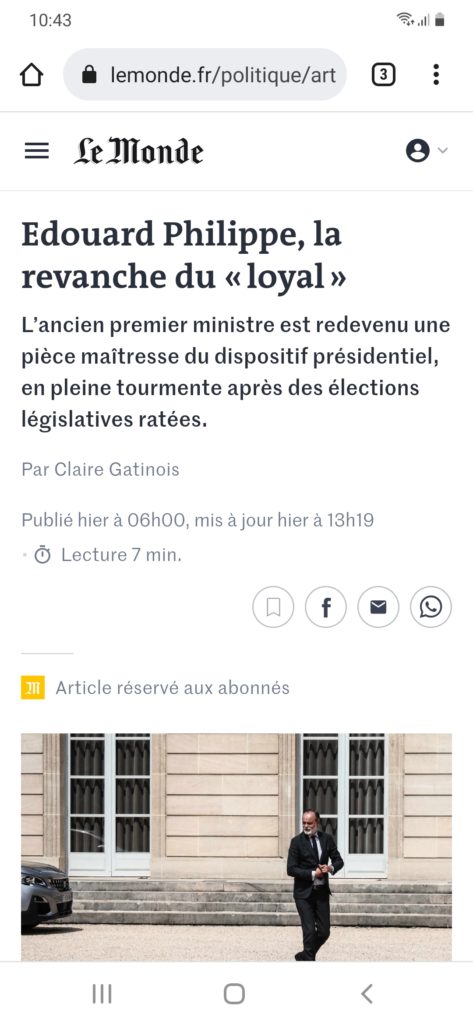
Damien quant à lui a beau s’accrocher, Emmanuel sait qu’il ne pourra plus rien tirer de sa prise de guerre. « Il est grillé », « foutu », se murmure-t-il dans les couloirs. Mais le président de la disruption ne veut plus batailler. En vérité il se trouve au pied du mur.
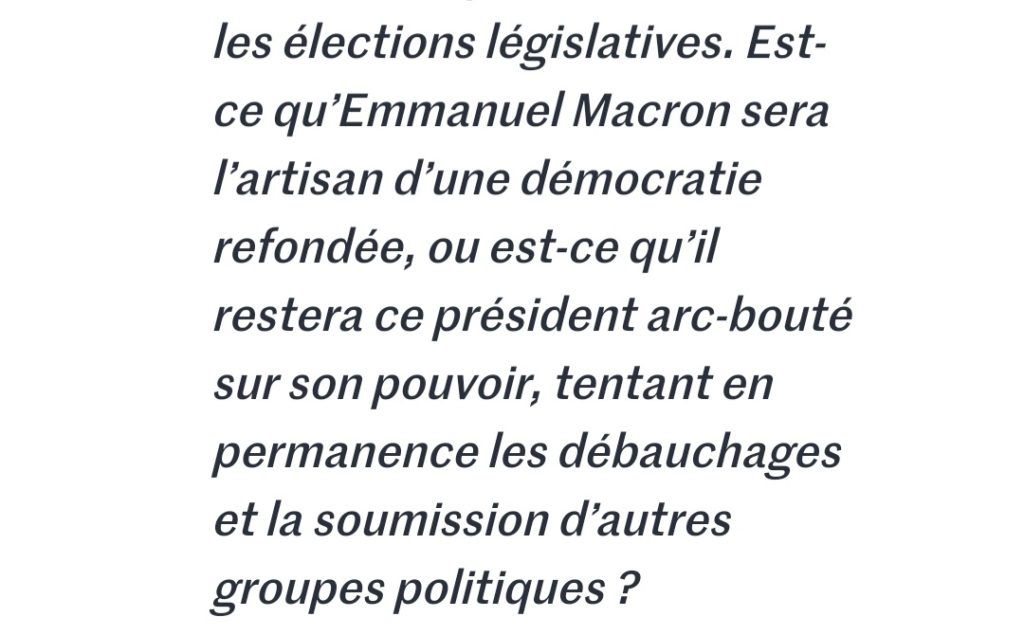
Pire, il peut bien aller trouver quelques heures refuge et réconfort auprès de ses frère et sœur du royaume de l’Union, l’illusion reste de courte durée. Il sent qu’au fond, il est seul à présent.

Alors. Manu a-t-il fait son temps ? Est-il allé trop loin ? Ou plutôt pas assez ? Mais surtout, parviendra-t-il à puiser en lui la force de rebondir ?

Vendredi 24 juin

Samedi 18 juin
À voir, ce travail critique très abouti sur l’oeuvre d’Arnaud Desplechin. Tout y est passionnant. De mon côté j’en retiens d’abord ce qui est dit du caractère littéraire du cinéma de Desplechin, et plus largement de tout énoncé : sa capacité à exister sans contexte, sa volatilité, son « autonomie » et sa « solitude » (1:02:20). Avec, pour exemple, le début de Comment je me suis disputé où le discours du narrateur se déroule dans des contextes différents (Paul Dedalus chez le psychanalyste ; puis dans un café). Ce passage vidéo est lumineux.
J’extrapole désormais à dessein pour une application purement romanesque. Dans un texte, l’énoncé même inchangé montre une immense plasticité, permettant ainsi « plein d’usages différents ». Inséré dans des situations variées, il change de signification. Un même énoncé peut se démultiplier et muter, il ne s’appauvrira pas. Répété, au contraire, il se chargera sémantiquement. Cette drôle d’autonomie du discours a été maintes fois relevée, éprouvée et célébrée par les auteurs. Car c’est bien cet aspect-là avant tout autre qui produit sa littérarité (par exemple, Perec dans La vie mode d’emploi reprend des paragraphes entiers à divers points du roman). Littéraire, un énoncé ne peut être réduit aux circonstances dans lesquelles il apparaît ? Mais si c’est vrai c’est trop bon ! La belle matière que voici ! L’entrée dans la modernité a clairement permis de jouer de cette singularité du langage.
Sans grande originalité donc, mais tout de même en prise – et à pleine poigne – avec la bête, c’est pile sur ce point que je me trouve travailler pour la scène finale de Trois cafés.
Dimanche 5 juin

« Je ne concours que lorsque je suis sûr de gagner. » (ce jour, un drôle d’ami, autonome, bienheureux et fin stratège)


Vendredi 3 juin
La diffusion des films de Maurice Pialat est une merveilleuse occasion de parler de Depardieu, acteur dont j’ai déjà évoqué le talent dans un billet précédent mais jamais le dos. Car c’est peut-être ce qu’il a, avec sa gueule et sa voix, de plus singulier, de plus marquant et de plus beau dans nombre de ses films : ce dos large, épais, légèrement voûté, et tombant en toboggan inversé jusqu’au niveau des reins. Un dos qui le fait avancer quels que soient la scène et le récit, comme implacable, sans le moindre flageolement. Lui donne l’allure d’un bulldozer et celle d’un animal. Dans ces films-là, dont Le garçu, ce dos paraît aussi puissant qu’harmonieux.

Or c’est d’abord de ce dos que vient à Depardieu cette incroyable présence au monde. Du dos d’abord, bien avant une supposée assurance « naturelle ». Car le corps est seul à faire le caractère, si bien que l’on peut affirmer que l’état d’esprit est toujours un état du corps. Nos traits ne sont rien d’autre que chair, os et nerfs.

Pour Depardieu, ce seront les dorsaux, chez lui très tôt voûtés, qui lui feront tenir ses grandes mains vers l’avant et si bas. Ils les rendent un peu molles, presque pataudes, simiesques, sauf lorsqu’elles tiennent une cigarette et remontent vers la bouche pour qu’elle tire une bouffée. Ce sont ses dorsaux aussi qui lui font tenir sa tête comme mettant au défi, mais avant toute autre chose pour empêcher celle-ci de plonger vers le sol. Le visage doit lutter pour regarder le monde, alors le menton carré en se relevant prend un air d’engagement.
C’est enfin la courbe du dos, tandis que celui-ci se plante de biais en plein dans les hanches, qui libère ses jambes du poids si imposant du torse. Chez Depardieu haut et bas sont séparés. Les jambes peuvent se mouvoir aisément. Droites sur toute la longueur, sans jamais s’avachir. Dans la marche le flanc s’ouvre, le genou tire vers l’extérieur. Les jambes se détachent de l’avant ventripotent. Elles semblent prêtes à partir pour aller danser la gigue. Ailleurs, sans lui.
